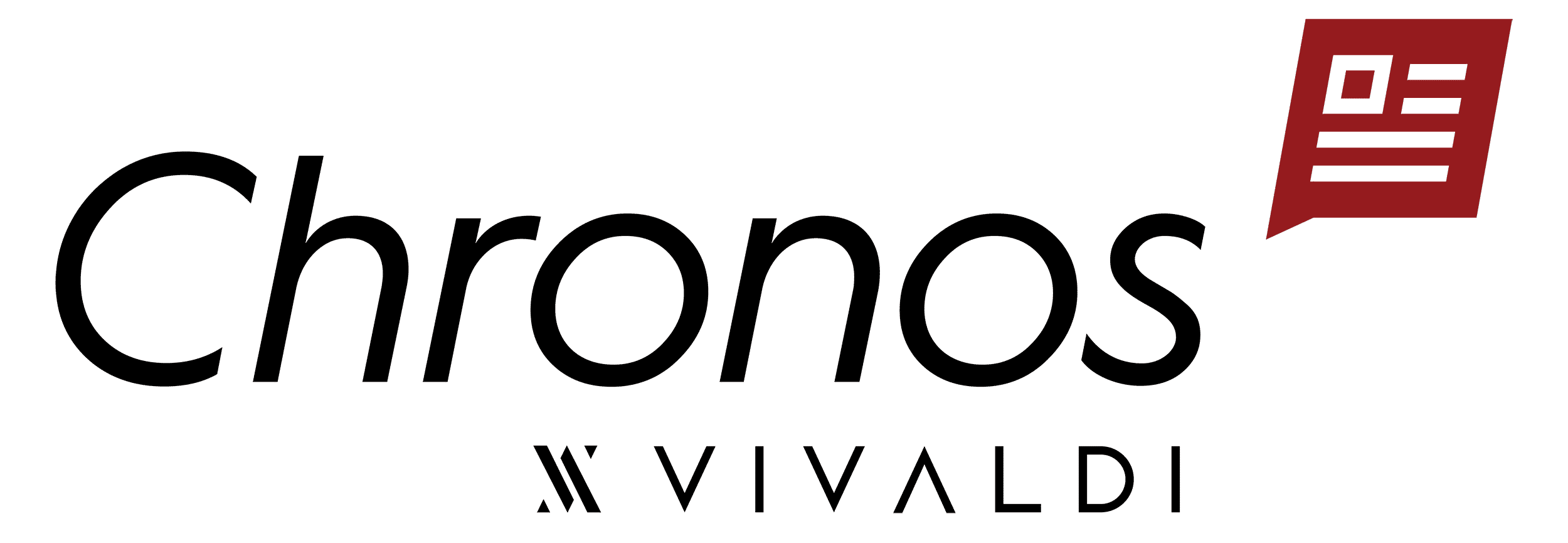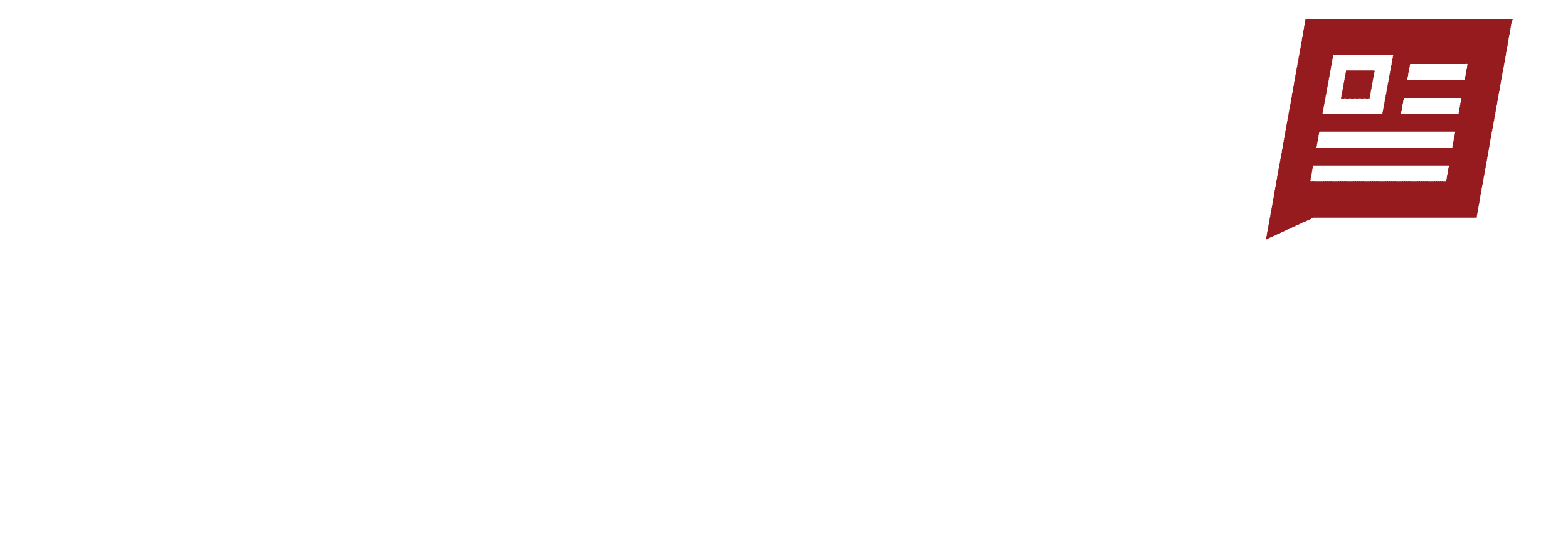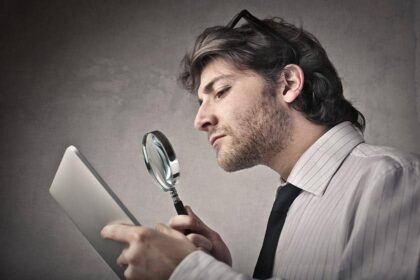Sécheresse, fissures et indemnisation : cadre légal de la garantie catastrophes naturelles (Cat-Nat)
Les épisodes de sécheresse prolongée constituent une réalité préoccupante, engendrant fréquemment des dommages matériels significatifs, notamment l’apparition de fissures sur les murs. Ces désordres soulèvent des questions majeures quant à leur prise en charge par les assurances, en particulier dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles (Cat-Nat). I – La garantie Cat-Nat La garantie Catastrophes Naturelles dite garantie Cat Nat est une extension de garantie obligatoire pour tous les contrats d’assurance de dommages. En vertu de l’article 125-1 du Code des assurances « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou…
Recevabilité en appel d’une demande en nullité du contrat : précision sur les prétentions nouvelles
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.674, n° 520 D Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel En appel, les parties ne peuvent, en principe, présenter de nouvelles prétentions. Toutefois, l’article 564 du Code de procédure civile autorise certaines exceptions, notamment lorsqu’une prétention vise à faire écarter celles de l’adversaire. De même, selon l’article 565, une prétention n’est pas considérée comme nouvelle si elle tend au même but, même si son fondement juridique diffère. De la réduction d’indemnité à la nullité du contrat À la suite d’un incendie partiel dans un immeuble assuré, l’assureur a invoqué une erreur sur la…
Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation
Le formalisme à respecter est crucial
Cession de titres à vil prix et conflits familiaux : une position différente entre le comité de l’abus de droit et l’administration fiscale
Le comité de l’abus de droit fiscal a rendu plusieurs avis concernant la qualification d’abus de droit en matière de cession de titres à vil prix qui n’ont pas été suivis par l’administration fiscale. Comité d’abus de droit du 3 avril 2025 - (Affaires n° 2024-32 M. A, n° 2024-33 Mme XA, n° 2024-34 Mme XB) En l’espèce, des cessions de titres avaient été effectuées pour le prix d’un euro symbolique. A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la cession des titres pour un prix symbolique était dépourvue de contrepartie et a mis en œuvre la procédure de…
Usage d’habitation : la loi Le Meur ne s’applique pas rétroactivement, selon la Cour de cassation
Cass. 3e civ., avis, 10 avr. 2025, n° 25-70.002, n° 15010 P+B Une loi renforçant le contrôle des locations touristiquesLa loi du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, a renforcé les moyens juridiques à disposition des collectivités pour encadrer les meublés touristiques. Elle a modifié les critères permettant de considérer un local comme affecté à l’usage d’habitation, et a doublé le plafond des amendes encourues en cas de changement d’usage sans autorisation préalable, le faisant passer de 50 000 à 100 000 €. Un changement substantiel des critères d’usageJusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, un local était présumé…
Évaluation des titres sociaux : les pouvoirs de l’expert désigné et du juge
La Cour de cassation vient rappeler les pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et juge qu’en cas de contestation, l’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations des parties, à charge pour le juge d’appliquer l’évaluation correspondante. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 23-24.041 L’article 1843-4 du code civil permet, lorsqu’il est prévu par la loi ou par les conventions, qu’en cas de cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un…
Les dégradations locatives ne peuvent pas faire l’objet d’une injonction de payer
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501, n° 176 B Une créance contractuelle, mais non déterminée par le contrat La Cour de cassation rappelle qu’une créance résultant de dégradations locatives ne peut pas être recouvrée par la voie de l’injonction de payer, dès lors que son montant ne peut être fixé uniquement en vertu du contrat de bail. Selon l’article 1732 du Code civil, le locataire est responsable des dommages survenus pendant la durée du bail, sauf s’il prouve qu’ils ne lui sont pas imputables. Ainsi, lorsqu’il restitue le logement en mauvais état, il engage sa responsabilité contractuelle et…
Notion d’exclusion de garantie et assurance responsabilité civile décennale
L’activité de l’assuré qui ne rentre pas dans le champ de la garantie de son assureur constitue une non garantie, et non pas une exclusion de garantie en ce qu’elle ne tient pas aux circonstances de la réalisation du risque Source : Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n° 23620.177 C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit : « … Réponse de la Cour6. La cour d'appel, après avoir énoncé que la clause d'exclusion de garantie est celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation du…
Taxation d’office et saisine de la commission en matière de TVA
Le Conseil d’État vient rappeler les garanties procédurales du contribuable en cas de taxation d’office en matière de TVA et notamment l’impossibilité de saisir la commission départementale des impôts dans ce contexte. Conseil d’État, 8ème chambre, 11 juillet 2025, n° 499147 La procédure de taxation d’office prévue par les articles L.66 et suivants du Livre des Procédures Fiscales s’applique lorsque le contribuable n’a pas respecté ses obligations déclaratives. Dans ce cas, l’administration établit d’office les bases d’imposition. Cette procédure se différencie ainsi de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du Livre des Procédures Fiscales…
Opposabilité des actes de cessions accomplis par un associé à ses héritiers
Ils ne sont pas considérés comme des tiers à l’acte
Le notaire doit conseiller spontanément les parties avant leur engagement définitif
Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-18.737, n° 349 F-D Un devoir d’information préalable et complet Le notaire est tenu de fournir un conseil éclairé et spontané aux parties avant toute prise d'engagement définitif. À défaut, il engage sa responsabilité professionnelle. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé cette exigence à l’occasion d’un litige opposant des vendeurs de terrain à leur notaire. Les faits : omission d’information sur une imposition prévisible En 2014 puis en 2017, un couple avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un terrain non bâti à une société. L’achat a été concrétisé…
Délai décennal et mise en cause de l’assureur
L’assignation doit être délivrée à l’assureur avant l'expiration du délai décennal, même en tenant compte de la prolongation de deux ans correspondant au temps où l'assureur est encore exposé au recours de son assuré. Cass.3ème Civ., 10 juillet 2025, n23-20.135 C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt inédit. En l’occurrence, un maitre d’ouvrage avait confié à un architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à une entreprise, également assurée en responsabilité civile décennale qui avait sous-traité…