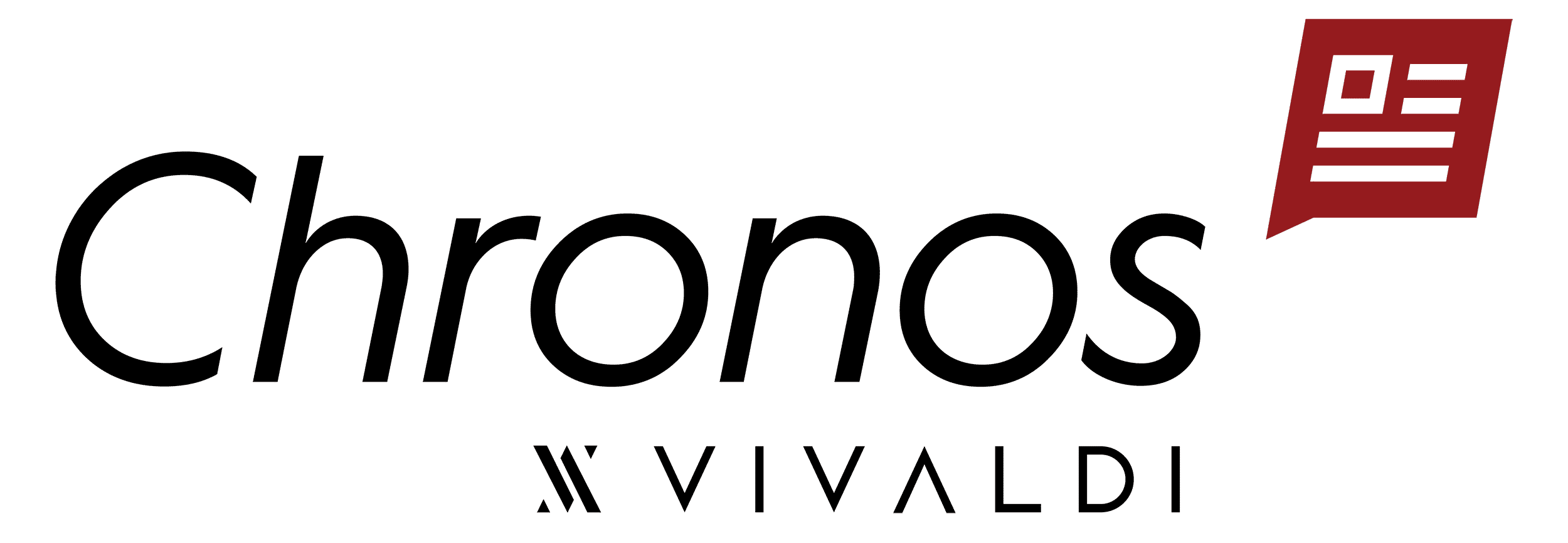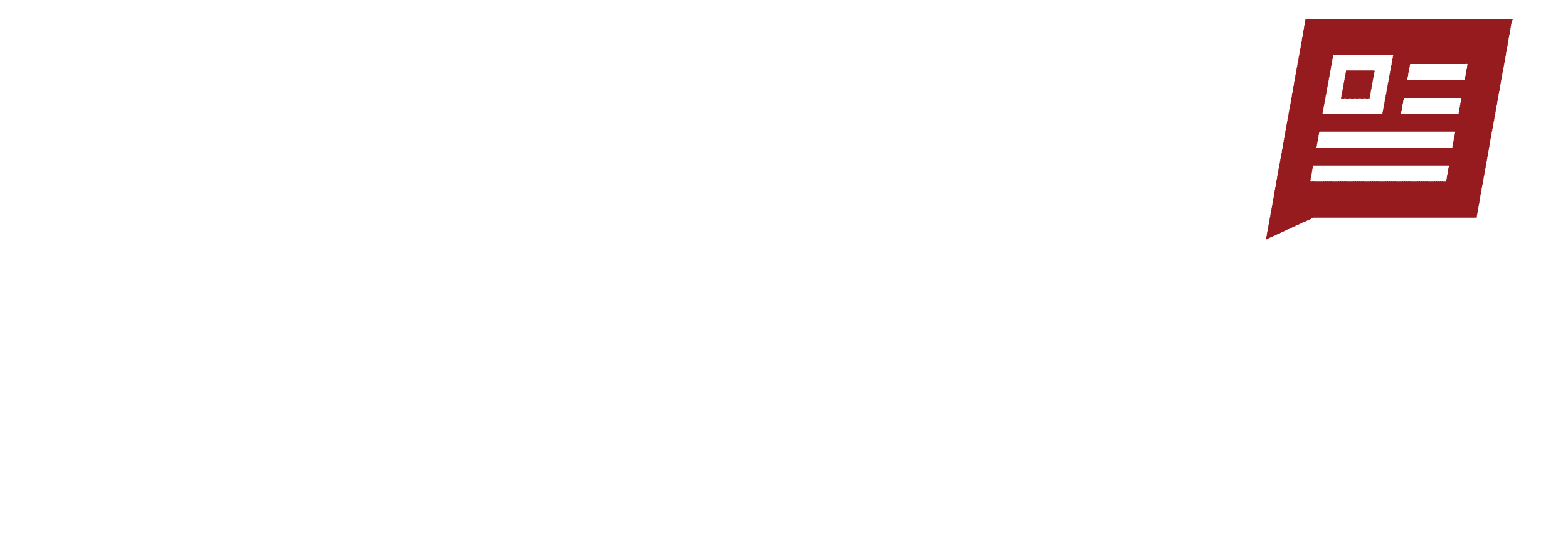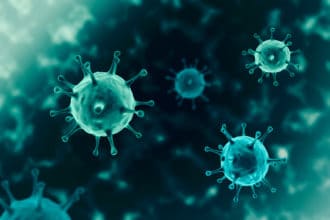Le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de consacrer la notion de préjudice nécessaire, ou automatique. Ainsi, le simple constat de la violation par l’employeur de certaines règles impose au juge d’octroyer une indemnité, sans qu’il soit nécessaire démontrer l’existence d’un préjudice pour le salarié[1].
Puis, l’arrêt du 13 avril 2016 a marqué la fin – temporaire – de la théorie du préjudice automatique et il appartenait désormais au salarié, en cas de manquement de l’employeur, de justifier du préjudice allégué[2].
Finalement, depuis 2016 la jurisprudence a infléchi et a désormais retenu, pour certaines hypothèses au cas par cas un droit à indemnisation sur le simple constat de la violation d’une règle par l’employeur. A titre d’illustration, on peut citer le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail[3] ou encore l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel[4].
Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, le salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement quelques semaines après l’expiration de son mandat syndical. L’employeur avait essuyé un refus de l’autorisation de licencier par l’inspecteur du travail un an plus tôt. Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.
La cour de Cassation énonce que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation. Ainsi, en cas de reconnaissance d’une discrimination syndicale, il y aura automatiquement une condamnation de l’employeur au bénéfice du salarié. Il s’agit là d’un nouveau préjudice automatique reconnu par la Cour de cassation et qui permet au salarié victime de discrimination syndical de ne pas avoir à démontrer un préjudice.
Sources : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124
[1] Cass. soc., 29 avr. 2003, n° 01-41.364, Bull. civ. V, n° 145
[2] Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293
[3] Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21.636 FS-B
[4] Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-14.392 FS-P+B ; Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-22.224