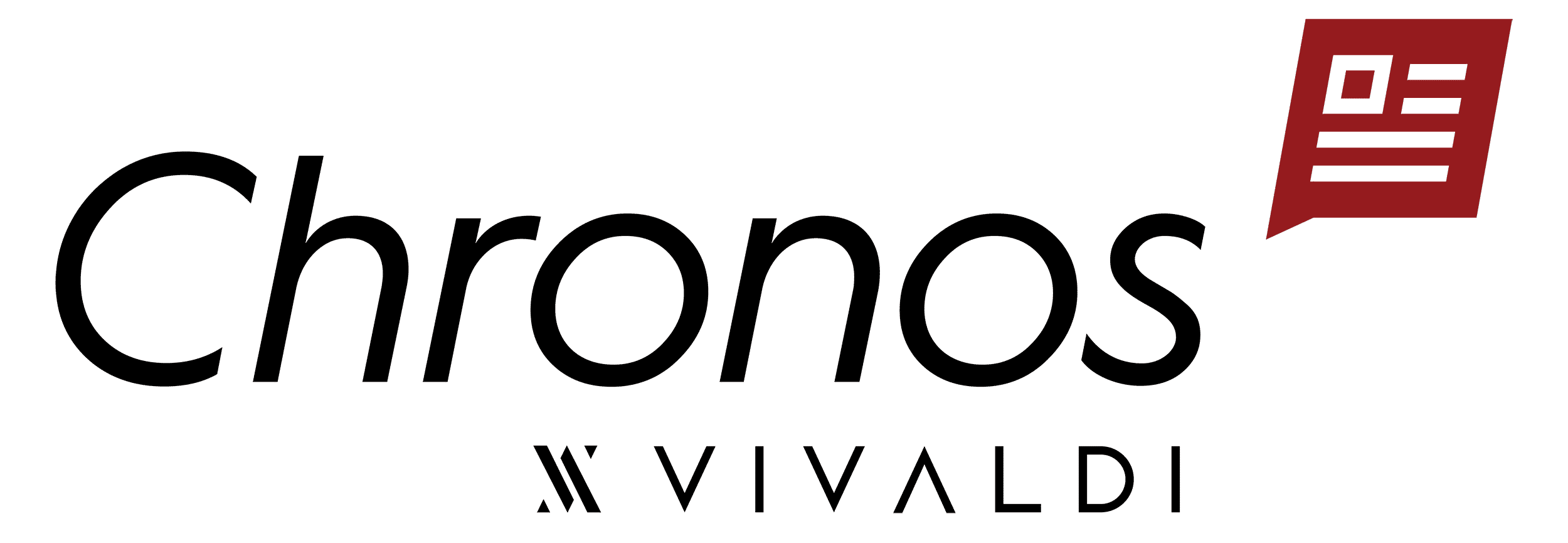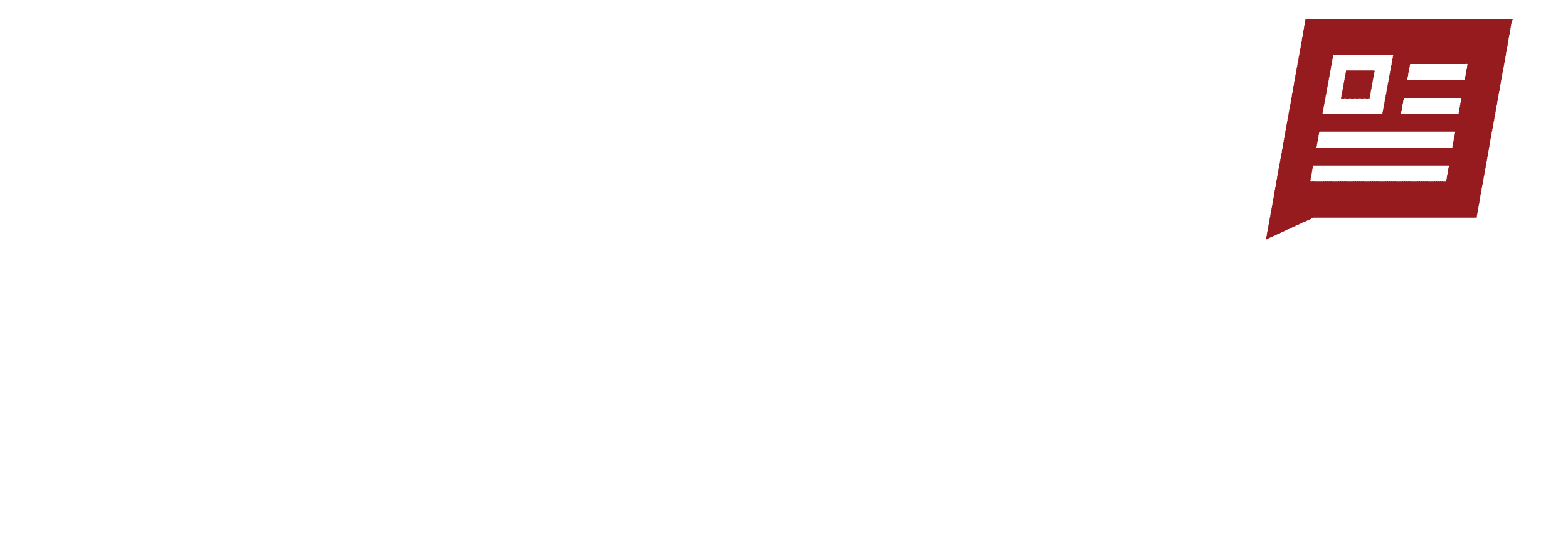L’arrêt du 30 janvier 2025 précise le régime social applicable aux indemnités transactionnelles lorsque celles-ci comportent une part de dommages et intérêts destinée à compenser un préjudice subi par le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail.
La résolution amiable d’un différend entre des parties peut se solder par une transaction signée par chacune d’entre elles. La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître[1]. La matière prud’homale n’échappe pas à la possibilité pour les parties de transiger.
En l’espèce, une transaction a été conclue entre le salarié et son ancien employeur et elle prévoyait notamment le versement au salarié d’une somme brute de 105.000 € en réparation des « préjudices notamment moraux et professionnels dont le salarié entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi ».
En exécution de l’accord, l’employeur verse au salarié la somme de 81.908,95 €, déduction faite des cotisations sociales applicables sur la fraction de l’indemnité transactionnelle qui dépassait la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)[2].
Le salarié conteste le montant résultant de la déduction faite des cotisations sociales et délivre à son ancien employeur un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d’obtenir le paiement de la somme retenue.
Dans l’arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle d’une part que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux PASS, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts et d’autre part que n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition les sommes qui « ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts. »
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que « la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. » La Cour d’appel avait alors déduit que cette somme avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture, de sorte que l’indemnité transactionnelle avait une nature indemnitaire et non salariale.
Ainsi, en raison de la nature indemnitaire de l’indemnité allouée au salarié, celle-ci ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour l’intégralité de son montant.
En définitive, l’exonération a vocation à s’appliquer dès lors que l’indemnité répare un préjudice, quand bien même elle porterait sur la rupture du contrat de travail.
En cas de litige sur la nature de l’indemnité, la jurisprudence retient qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’indemnité concoure à l’indemnité d’un préjudice[3].
Il est important de noter que ces règles jurisprudentielles divergent du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), opposable à l’Administration.
Le BOSS énonce, sur le fondement de l’article 80 duodecies du Code des impôts, qu’« En cas de versement à la fois d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies s’appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail [4]. »
Le BOSS indique : « Toutefois, en dehors des indemnités pouvant être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi, une somme représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l’assiette des cotisations, lorsque l’employeur apporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié. Il en va ainsi lorsqu’une décision de justice constate la réalité de ce préjudice et considère que les sommes versées constituent des dommages-intérêts[5]. »
D’une part le texte est muet sur l’application de la limite d’exonération fixée à deux PASS, d’autre part le BOSS fait référence à une décision de justice qui constate la réalité de du préjudice moral ou personnel. Ces constatations entraînent un risque de redressement par l’Administration.
L’importance de la rédaction du protocole d’accord transactionnel est donc essentielle pour éviter tout risque de contentieux en cas de contrôle de l’Administration. L’objectif étant d’éviter toute zone grise.
Sources : Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-18.333, FS-B
[1] C. civ., art. 2044
[2] Code de la sécurité sociale, art. L. 241-3
[3] Cass. soc., 15 mars 2018, n° 17-10.325 ; Cass. soc., 21 juin 2018, n° 17-19.432
[4] BOSS, Litiges liés à la rupture du contrat de travail ou à la cessation des fonctions des dirigeants de société, Chap. 10, § 1670
[5] Idem, § 1720