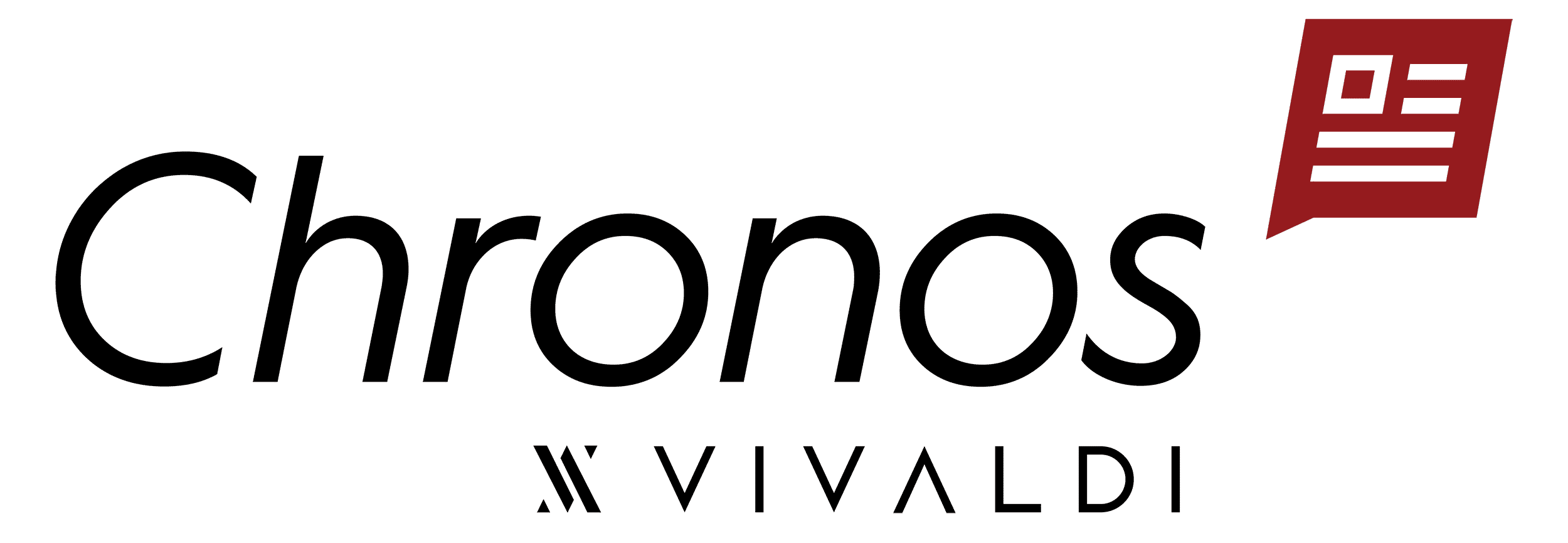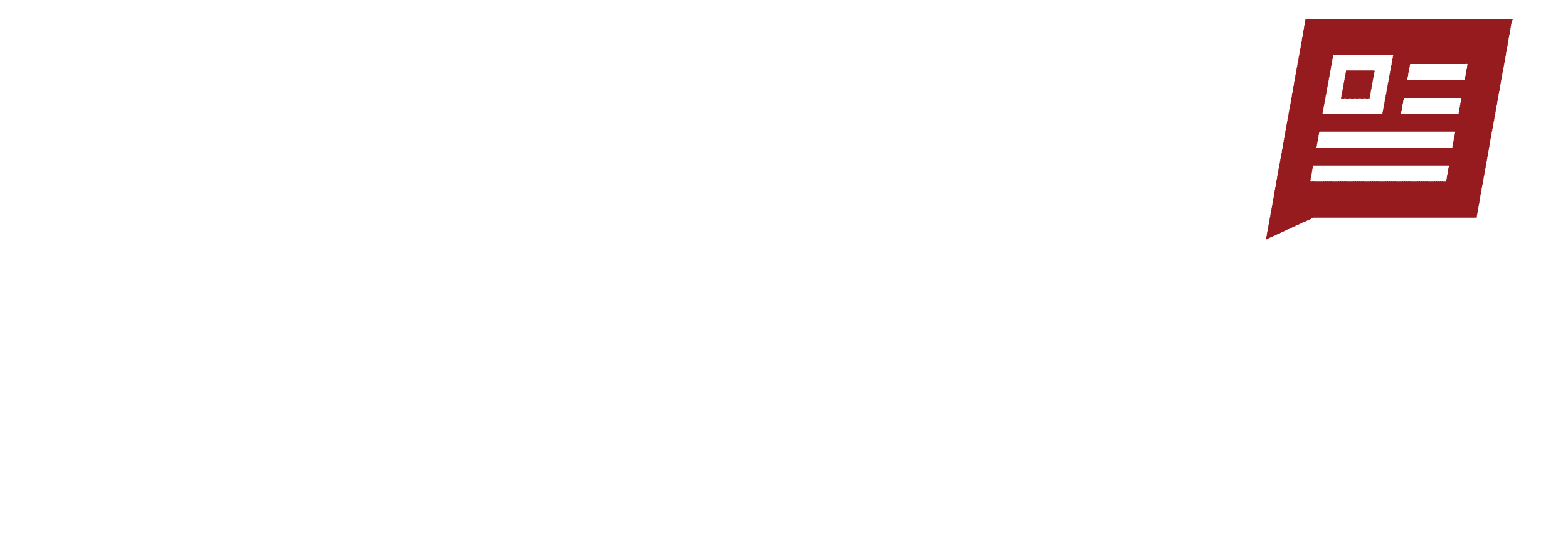Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur (ou son assureur) contre le fournisseur ou son assureur court non pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur, ou à défaut, de l’exécution de son obligation à réparation.
Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-18.781
I –
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, le maître de l’ouvrage a confié le lot bardage à une entreprise. Cette dernière s’est approvisionnée en chevrons de bois auprès d’un fournisseur.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour l’opération.
Après réception, des désordres ont été constatés, portant sur l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage. Le maître de l’ouvrage a alors déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Se prévalant d’un défaut affectant les matériaux fournis, l’entreprise exécutante et son assureur, agissant aussi en qualité d’assureur dommages ouvrage, ont assigné le fournisseur et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, à la suite d’une expertise judiciaire.
Postérieurement à l’assignation, l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé le maître de l’ouvrage.
Le fournisseur et son assureur ont opposé une fin de non-recevoir, fondée sur la prescription de l’action en garantie.
II –
La cour d’appel a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre le fournisseur des matériaux et son assureur, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle a jugé que le délai de prescription prévu à l’article 1648 du Code civil courait à compter de la date de connaissance du vice, qu’elle a fixée au plus tard au 25 juillet 2017, date à laquelle les rapports d’analyse permettaient d’identifier l’origine du désordre.
Les assignations ayant été délivrées en mai 2020, la cour a donc retenu que le recours était forclos.
L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer forcloses ses demandes formées contre le fournisseur et son assureur et soutient que, dans le cadre d’un recours fondé sur la garantie des vices cachés exercé par un entrepreneur contre son fournisseur, le bref délai ne court pas à compter de la simple connaissance du vice, mais à compter de l’assignation de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage ou, à défaut, de la première demande en indemnisation.
En retenant un point de départ antérieur à toute mise en cause ou demande de réparation dirigée contre l’entreprise, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1648 du Code civil et la nature récursoire de l’action engagée.
III –
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil.
Elle rappelle que, s’agissant d’une action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par un constructeur ou son assureur après indemnisation du maître de l’ouvrage, le point de départ du délai biennal ne correspond pas à la découverte du vice, mais à l’assignation en responsabilité du constructeur, ou, à défaut, à l’exécution de son obligation de réparation.
En l’espèce, la cour d’appel, en faisant courir le délai de prescription à compter de la connaissance du vice par l’entreprise, sans tenir compte du caractère récursoire de l’action engagée après indemnisation, a violé l’article 1648 du Code civil.
IV –
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que l’action en garantie des vices cachés exercée par un constructeur ou son assureur contre un fournisseur n’est pas soumise au même point de départ du délai que celle du maître d’ouvrage.
Lorsqu’elle intervient après l’exécution de l’obligation de réparation du constructeur envers le maître de l’ouvrage, notamment à la suite d’une indemnisation amiable, l’action a une nature récursoire. Le délai biennal de l’article 1648 du Code civil court alors non pas à compter de la simple découverte du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur, ou à défaut, de l’exécution de son obligation à réparation.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence tendant à protéger l’effectivité du recours du constructeur contre les coauteurs du dommage, en tenant compte de la réalité procédurale et financière de son intervention.
Il clarifie également la coordination entre la prescription biennale du droit des vices cachés et les mécanismes de subrogation ou de recours, notamment en matière d’assurance construction. En cela, il renforce la sécurité juridique du recours subrogatoire et prévient une extinction prématurée de l’action du constructeur ou de son assureur.