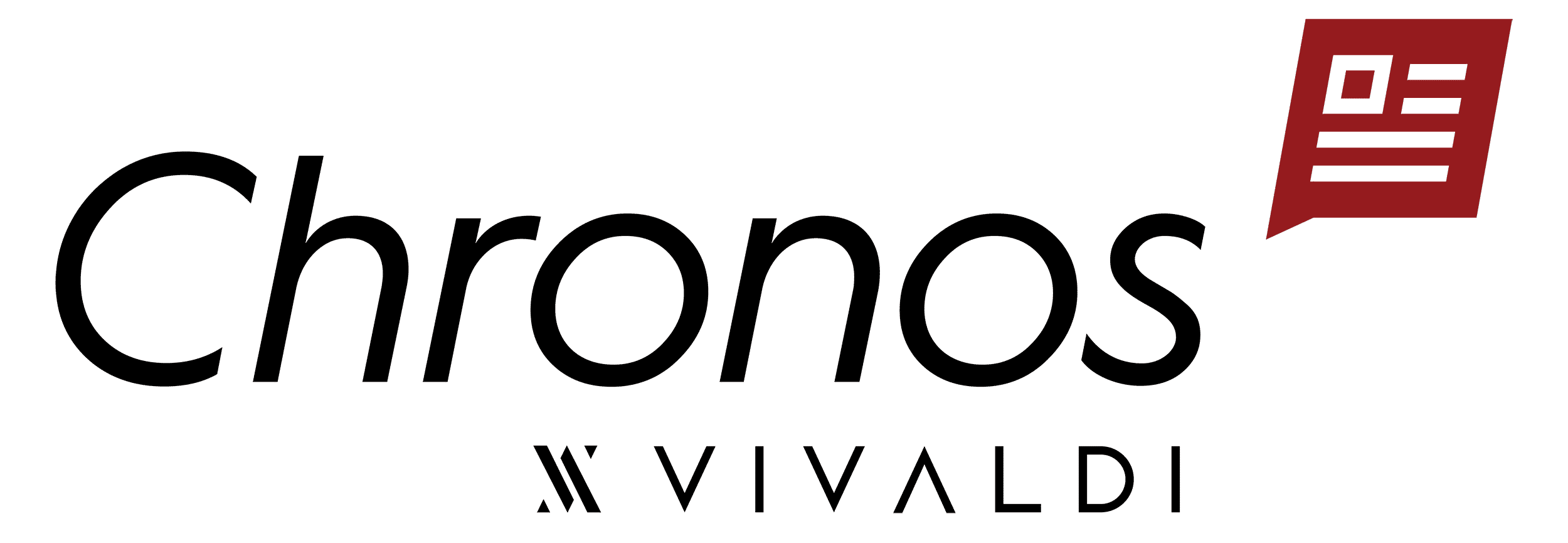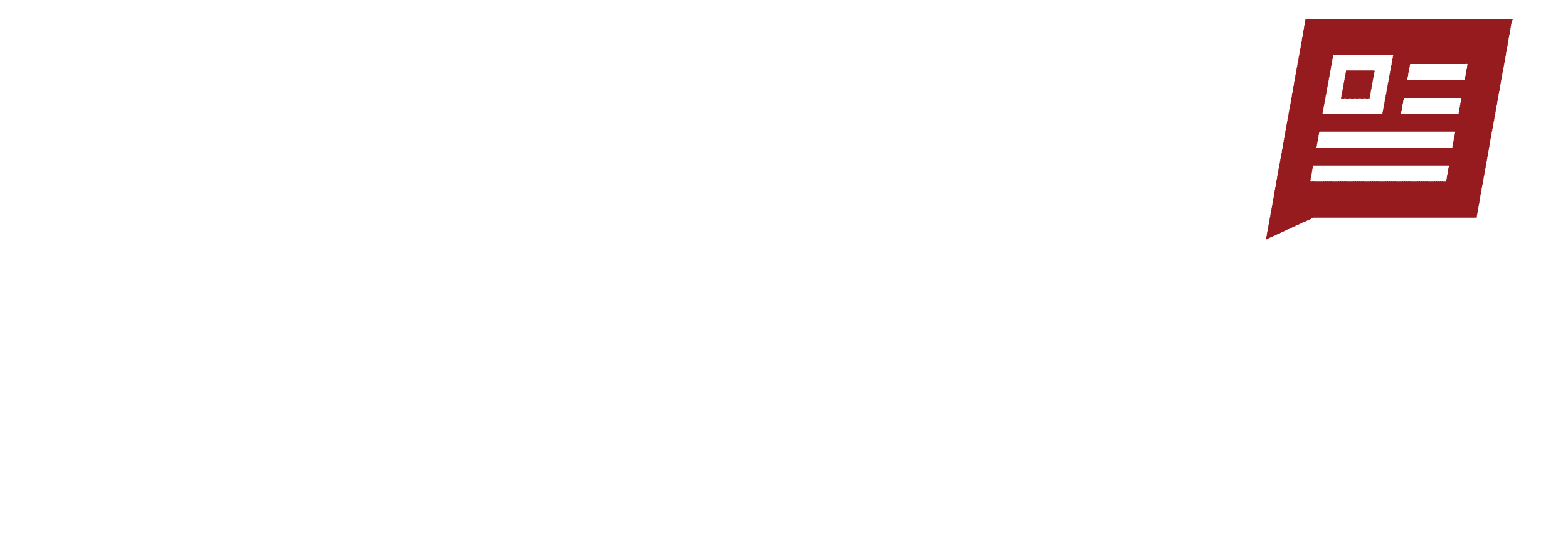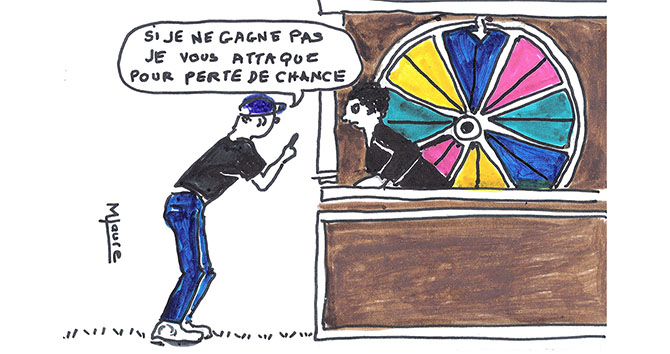Par deux arrêts rendus le 27 juin 2025, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé les limites du principe dispositif dans l’hypothèse où la victime d’un dommage sollicite une indemnisation intégrale, alors qu’elle n’a en réalité subi qu’une perte de chance.
Cass. Ass. Plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812
I –
Après avoir consacré le droit à réparation de toute perte de chance et écarté l’exigence de prouver son caractère « raisonnable », la Cour de cassation va plus loin : elle admet désormais que la victime puisse obtenir réparation même lorsqu’elle demande l’indemnisation de son dommage entier, alors qu’elle n’a en réalité subi qu’une perte de chance.
La Cour de cassation a parfois jugé que le juge devait indemniser une perte de chance constatée, même si seule la réparation intégrale avait été demandée. Mais d’autres décisions, s’appuyant sur une lecture stricte du principe dispositif (CPC, art. 4 et 5), ont refusé d’imposer au juge de rechercher ou de soulever une perte de chance non expressément invoquée par la victime.
Si le juge peut interpréter la volonté du demandeur au-delà de la lettre de ses conclusions, cette faculté relevait jusqu’ici de son pouvoir souverain d’appréciation. En érigeant désormais en principe l’interdiction pour le juge de refuser d’indemniser une perte de chance au seul motif que la réparation intégrale a été demandée, l’assemblée plénière instaure une dérogation explicite au principe dispositif.
II –
Dans deux litiges récents, la Cour de cassation a été confrontée à la question de l’indemnisation de la perte de chance.
Dans la première affaire, une société reprochait à son avocat un défaut de conseil relatif à une clause de non-concurrence, mais sa demande d’indemnisation a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas sollicité la réparation d’une perte de chance, pourtant caractérisée.
Dans la seconde, une SCI assignait un notaire pour manquement à son devoir de conseil lors d’une vente immobilière. Malgré la reconnaissance de la faute du notaire, la Cour d’appel a écarté toute indemnisation en estimant que le préjudice relevait d’une perte de chance non demandée par la SCI. Ces affaires illustrent la difficulté pratique liée à l’articulation entre la caractérisation de la perte de chance et le respect du principe dispositif.
Dans sa décision, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a censuré les arrêts de Versailles et de Limoges en combinant à la fois des considérations procédurales et substantielles. Elle rappelle d’abord la définition classique de la perte de chance comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, constituant un préjudice réparable distinct de l’entier dommage.
Mais elle souligne aussi que ce préjudice, bien que distinct, reste dépendant de l’entier dommage dont il constitue une fraction. Cette dépendance, qui va au-delà du simple calcul de l’indemnisation, marque le cœur de sa motivation et confère une portée particulière à la solution retenue, puisqu’elle permet de relier la perte de chance au dommage principal jusque dans ses implications procédurales.
III –
En s’appuyant sur l’article 4 du code civil relatif au déni de justice, l’assemblée plénière justifie sa solution en considérant qu’un juge ne peut refuser d’indemniser un dommage qu’il a constaté, même si seule la réparation intégrale a été demandée. Elle en déduit deux principes majeurs : le juge peut rechercher l’existence d’une perte de chance tout en respectant l’objet du litige, et il doit indemniser cette perte de chance dès lors qu’elle est caractérisée, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de demande expresse en ce sens.
Cette position dépasse le simple cadre des litiges impliquant des avocats ou des notaires : elle concerne toute situation où une perte de chance est en jeu. Paradoxalement, si les arrêts sanctionnent les professionnels mis en cause, la solution retenue tend aussi à protéger, de manière plus générale, les professions juridiques. En effet, en élargissant le rôle du juge dans l’identification et l’indemnisation de la perte de chance, la Cour réduit le risque que la responsabilité des praticiens soit engagée pour des manquements d’information, de conseil ou de simples maladresses formelles.