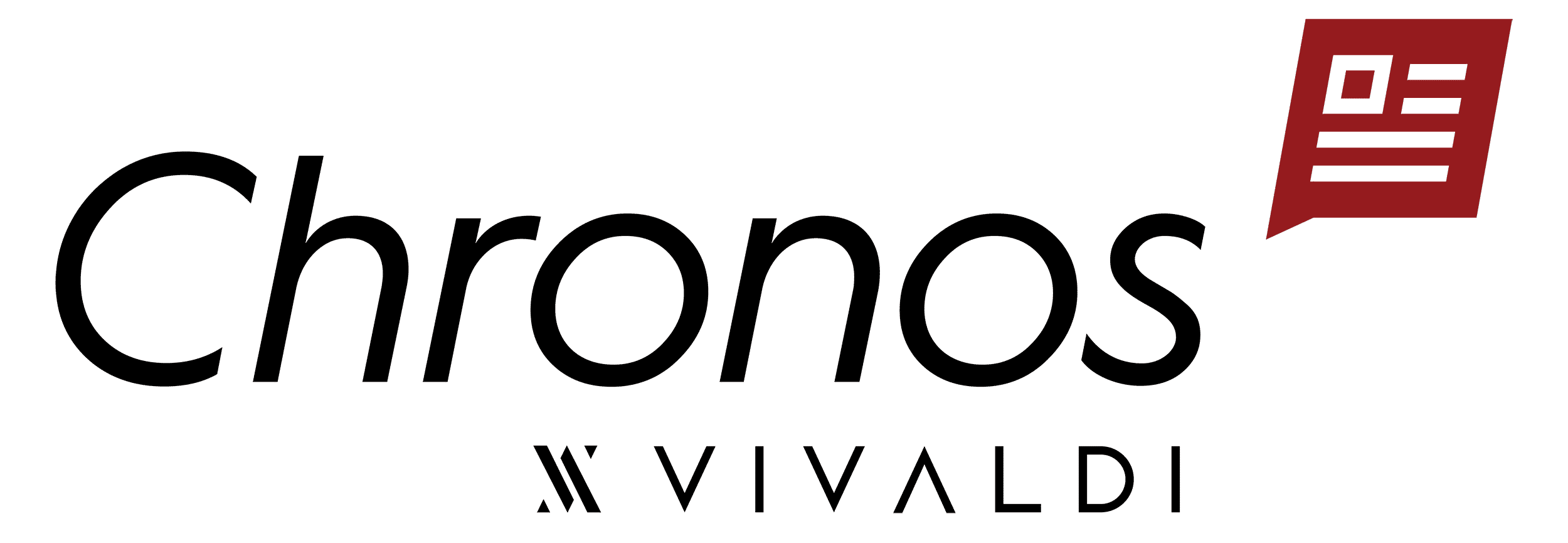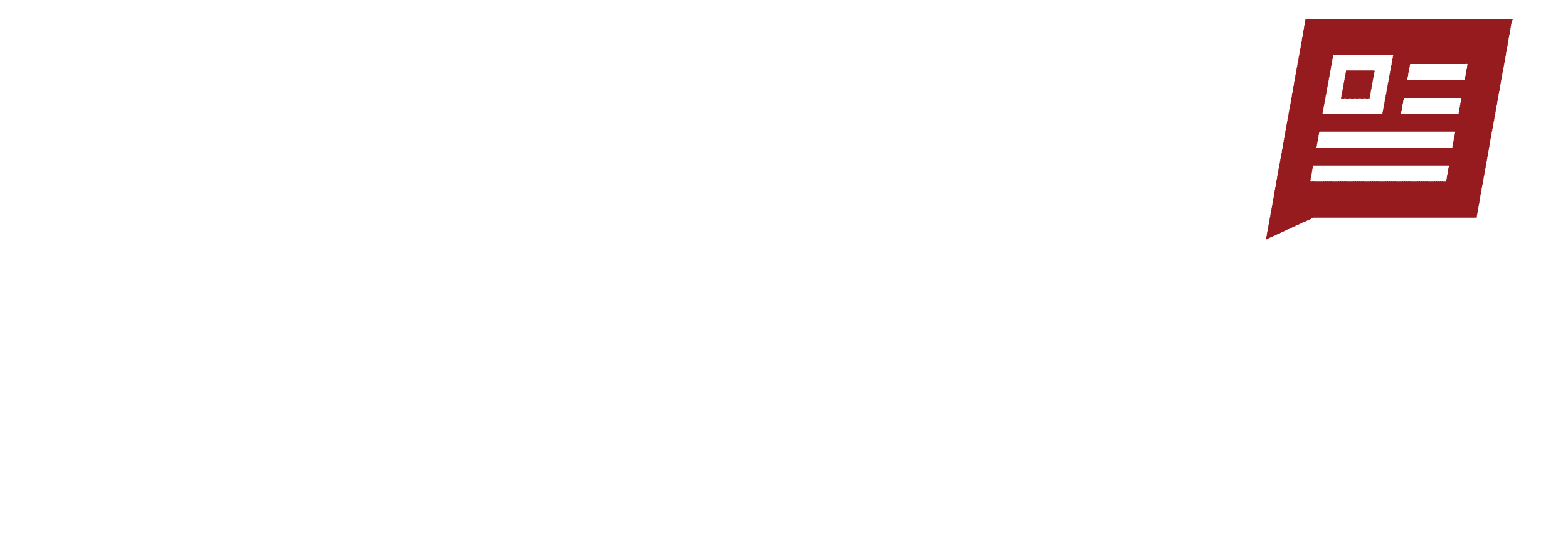Par un arrêt rendu le 26 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie concernant les conditions d’exercice de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du Code civil.
Cette action, ouverte au créancier, lui permet de faire déclarer inopposables les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits et ayant pour effet d’appauvrir son patrimoine. Parmi ses conditions classiques figure l’exigence d’une créance certaine, au moins en son principe, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit liquide ou exigible au moment de l’action.
Civ. 3ème, 26 juin 2025, n° 23-21.775
I –
Le 26 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt confirmant sa jurisprudence sur la condition d’une créance certaine, au moins en son principe, exigée pour la recevabilité de l’action paulienne.
L’affaire concernait des acquéreurs qui, après avoir constaté des désordres dans l’immeuble acheté, ont engagé une action en responsabilité contre les vendeurs. Ces derniers avaient entre-temps procédé à plusieurs opérations patrimoniales suspectes : donations de parts sociales et d’immeuble à leurs filles, puis cession d’autres parts sociales. Les acquéreurs ont alors exercé une action paulienne pour faire déclarer ces actes inopposables, estimant qu’ils étaient réalisés en fraude de leurs droits.
Après avoir obtenu une condamnation provisionnelle des vendeurs au titre des désordres, les demandeurs ont vu leur action paulienne jugée recevable en appel, la cour estimant que leur créance était certaine dans son principe à la fois lors des actes incriminés et lors du jugement. La Cour de cassation valide ce raisonnement, confirmant la continuité de sa jurisprudence : l’action paulienne peut être exercée dès lors que la créance existe en son principe, même si son montant exact n’est pas encore fixé.
Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans la consolidation du cadre protecteur des créanciers face aux manœuvres frauduleuses de leurs débiteurs.
II –
Pour rappel, l’action paulienne, qui permet à un créancier de faire déclarer inopposables les actes frauduleux accomplis par son débiteur, présente une nature hybride : elle se situe à la frontière entre mesure conservatoire et mesure d’exécution, sans se confondre avec l’une ou l’autre. Cette singularité a conduit la jurisprudence à assouplir progressivement ses conditions d’exercice, notamment en ce qui concerne la créance invoquée par le créancier.
Alors qu’en principe une action du créancier suppose une créance certaine, liquide et exigible, la Cour de cassation a évolué vers une exigence plus souple : une créance certaine en son principe suffit. Ce glissement jurisprudentiel, amorcé dès 2015 et confirmé par l’arrêt du 24 mars 2021[1], s’explique par la volonté de protéger efficacement le créancier face à des manœuvres frauduleuses qui, bien souvent, empêchent d’établir immédiatement la certitude ou le montant exact de la créance. Désormais, il est admis que l’absence de certitude résulte parfois de la fraude elle-même, ce qui ne doit pas paralyser l’action du créancier.
En parallèle, la Cour de cassation a également élargi la conception de la fraude et du préjudice du créancier. Par un arrêt du 29 janvier 2025, elle a jugé que la fraude paulienne peut être retenue même si l’acte du débiteur ne provoque pas un appauvrissement direct, dès lors qu’il rend les poursuites plus difficiles, par exemple en remplaçant un bien saisissable par des fonds plus faciles à dissimuler[2].
L’arrêt du 26 juin 2025 s’inscrit dans ce mouvement général de protection des créanciers. Il réaffirme que l’exigence d’une créance certaine en son principe suffit à la recevabilité de l’action paulienne et illustre la tendance de la Cour de cassation à privilégier l’effectivité de la protection du créancier sur une lecture formaliste des conditions classiques de l’action. Cette approche consolide la fonction préventive et corrective de l’action paulienne dans la lutte contre les actes frauduleux des débiteurs.
III –
L’arrêt rendu le 26 juin 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation illustre un nouvel approfondissement de la jurisprudence relative à l’action paulienne, en recentrant le débat sur la recevabilité de l’action.
La Cour rappelle que le créancier doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe, non seulement à la date de l’acte frauduleux, mais aussi au moment où le juge statue, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la question portait sur l’intérêt à agir des acquéreurs d’un immeuble affecté de désordres, qui n’avaient introduit leur action en responsabilité qu’après la réalisation d’actes patrimoniaux par le vendeur, soupçonnés de fraude. La défense contestait leur recevabilité au motif qu’ils ne disposaient pas encore d’une créance certaine au moment des actes de donation et de cession.
La Cour de cassation valide néanmoins l’analyse des juges du fond : une expertise de 2014 avait déjà mis en évidence des infiltrations graves rendant la maison quasi inhabitable, et une provision avait été allouée en 2017 par le juge de la mise en état. Ces éléments suffisaient à caractériser un principe certain de créance, confirmant la recevabilité de l’action paulienne.
L’arrêt se distingue par son centrage sur la notion de recevabilité, en lien avec l’intérêt à agir du créancier, et rappelle qu’en son absence, une fin de non-recevoir ferait disparaître toute possibilité de déclaration d’inopposabilité. La Cour souligne aussi la continuité entre le droit ancien (art. 1167) et le droit nouveau (art. 1341-2), confirmant que la solution vaut quel que soit le texte applicable.
En définitive, cet arrêt, publié au Bulletin, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle désormais claire : la souplesse dans l’exigence de certitude de la créance prime pour assurer l’effectivité de l’action paulienne et protéger le créancier face aux manœuvres dilatoires du débiteur.
[1] Com. 24 mars 2021, n° 19-20.033
[2] Com. 29 janv. 2025, n° 23-20.836