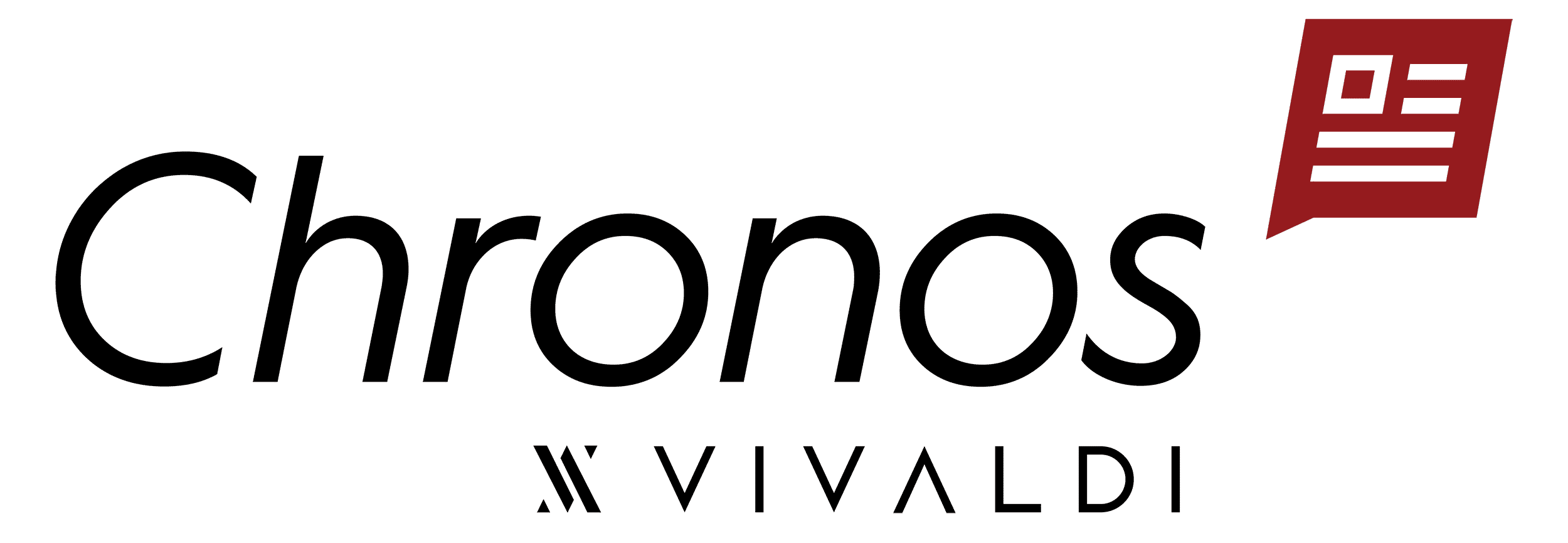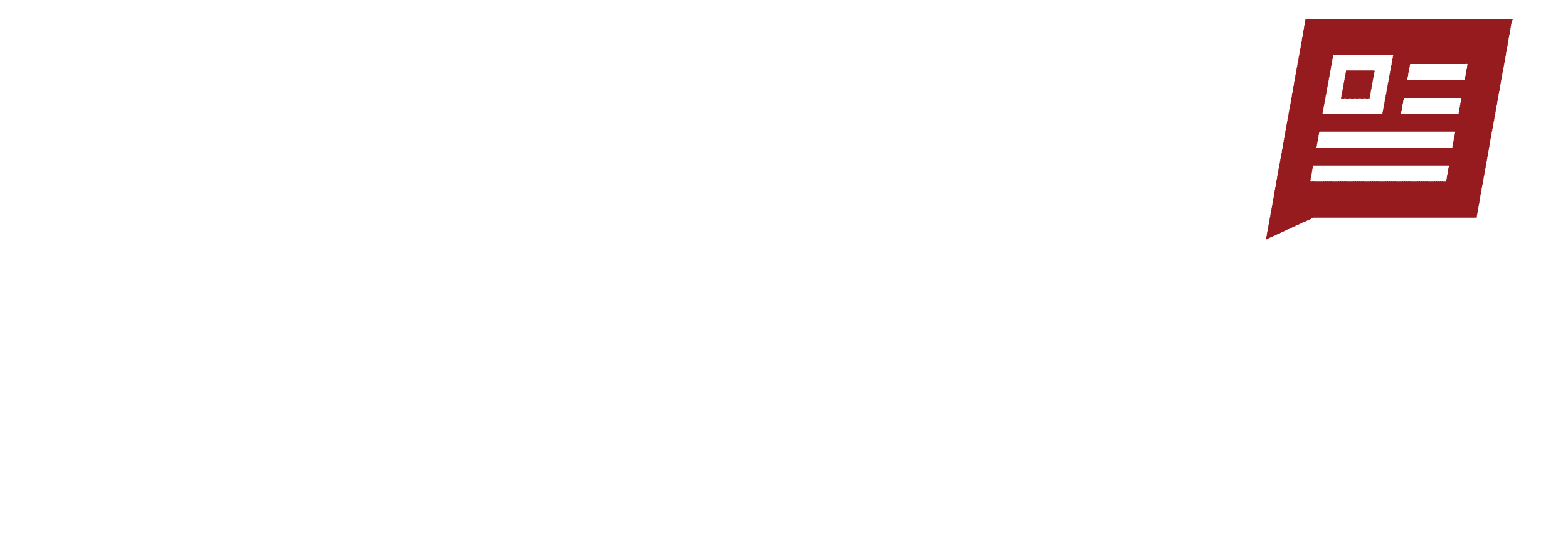Cass. 3e civ., avis, 10 avr. 2025, n° 25-70.002, n° 15010 P+B
Une loi renforçant le contrôle des locations touristiques
La loi du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, a renforcé les moyens juridiques à disposition des collectivités pour encadrer les meublés touristiques. Elle a modifié les critères permettant de considérer un local comme affecté à l’usage d’habitation, et a doublé le plafond des amendes encourues en cas de changement d’usage sans autorisation préalable, le faisant passer de 50 000 à 100 000 €.
Un changement substantiel des critères d’usage
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, un local était présumé à usage d’habitation s’il l’était au 1er janvier 1970, selon l’article L. 631-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Désormais, la présomption repose :
- soit sur une période fixe entre 1970 et 1976,
- soit sur une période glissante de 30 ans précédant la demande de changement d’usage ou la contestation.
Ces nouvelles modalités de preuve ont soulevé de nombreuses critiques doctrinales.
La Cour de cassation tranche la question de l’application dans le temps
Saisie pour avis par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour de cassation devait se prononcer sur deux interrogations soulevées dans une affaire où la Ville de Paris poursuivait un propriétaire pour avoir loué un bien en meublé de tourisme sans autorisation, avant l’entrée en vigueur de la loi Le Meur.
Les deux questions étaient :
- En cas de changement d’usage illicite antérieur à la loi du 19 novembre 2024, doit-on appliquer les anciens critères ou les nouveaux pour déterminer si le local était bien à usage d’habitation ?
- Si les nouveaux critères sont applicables aux faits passés, le sont-ils pour toutes les procédures, ou uniquement pour celles introduites après l’entrée en vigueur de la loi ?
Une règle de fond plus sévère, donc non rétroactive
La Cour a apporté une réponse claire :
« Lorsque l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du CCH est sollicitée pour un fait antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Le Meur, la détermination de l’usage d’habitation doit s’effectuer selon les critères de la loi ancienne. »
En conséquence, la seconde question devient sans objet : les nouveaux critères ne peuvent pas être appliqués aux faits passés.
Motivation de la Cour : principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères
Le raisonnement s’appuie sur le caractère répressif de l’amende encourue, qui s’analyse comme une punition (cf. Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.467). En matière de sanctions, une loi plus sévère ne peut s’appliquer rétroactivement.
La Cour note que la loi Le Meur :
- modifie les règles de fond relatives à la qualification d’un local à usage d’habitation,
- étend le champ d’application du régime d’autorisation préalable à des situations qui n’étaient pas concernées auparavant,
- durcit la sanction en doublant l’amende maximale.
Elle en déduit que la loi nouvelle, plus contraignante pour les propriétaires, ne peut produire d’effets que pour l’avenir.
Conclusion : sécurité juridique et respect des principes fondamentaux
La non-rétroactivité des nouvelles règles posées par la loi Le Meur est confirmée par la Cour de cassation, qui garantit ainsi :
- la sécurité juridique des propriétaires ;
- le respect du principe de légalité des peines, qui interdit l’application d’une sanction plus sévère à des faits antérieurs à la loi.
La réserve évoquée par les avocates générales, selon laquelle la poursuite d’une location après l’entrée en vigueur de la loi pourrait justifier l’application des nouveaux critères, n’a pas été retenue par la haute juridiction.