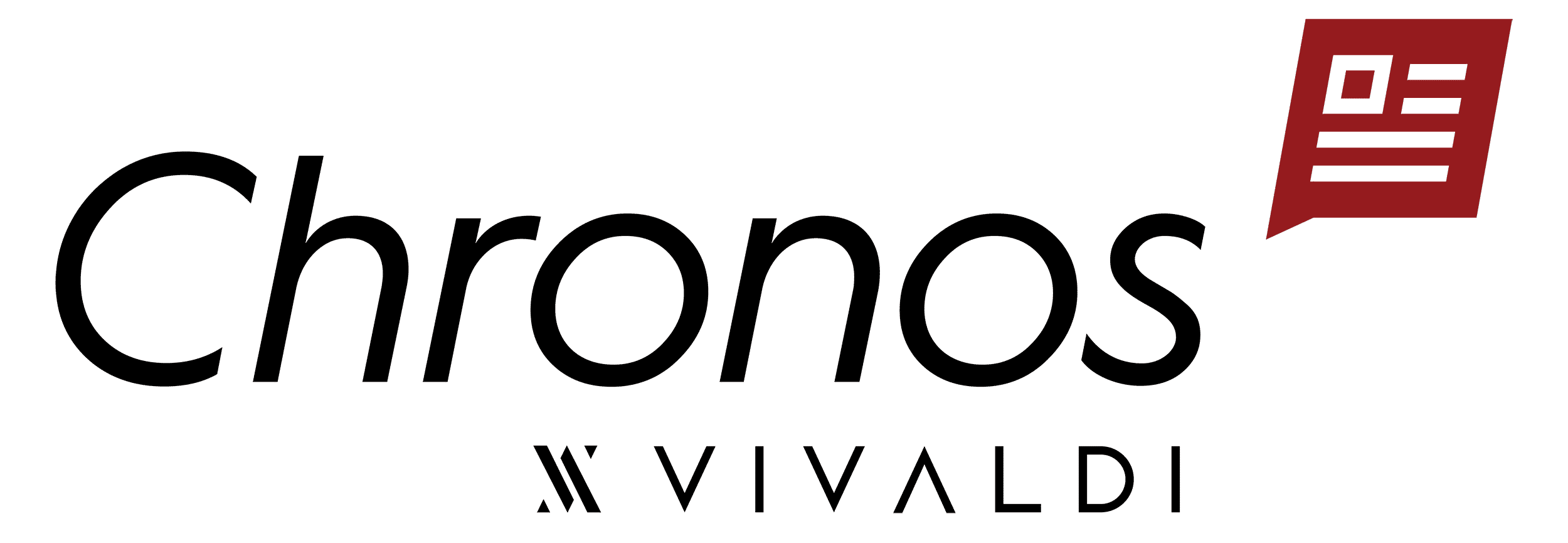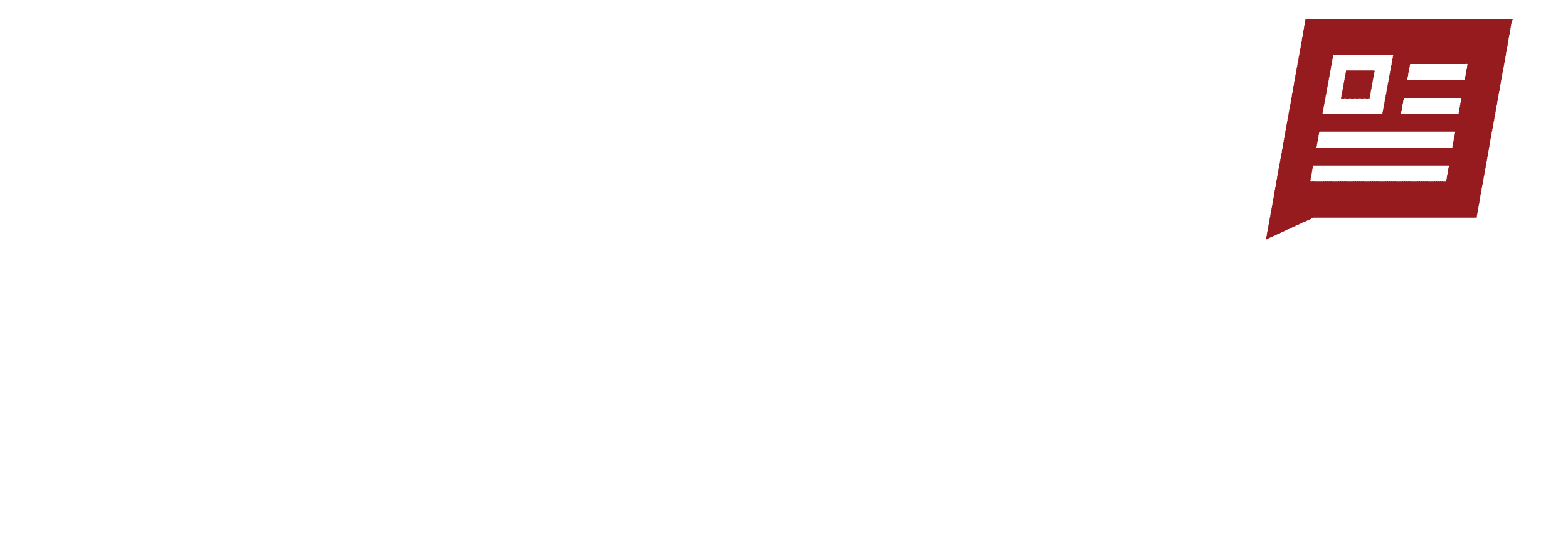Le 1er juillet 2020, la Cour de cassation ordonnait la restitution de La cueillette des pois, œuvre de Camille Pissarro, acquise par Simon Bauer et spoliée durant la Seconde guerre mondiale, et rejetait la demande d’indemnisation des collectionneurs en possession de l’œuvre. Ces derniers ont alors tenté de mettre en cause la responsabilité sans faute de l’Etat français devant le juge administratif, ce qui ne leur a pas davantage souri : le récent arrêt de la Cour administrative d’appel du 14 février 2025 rejette leur demande de condamnation de l’Etat en réparation de leur préjudice.
Source : CAA Paris, 4ème chambre, 14 février 2025, Inédit au recueil Lebon
I – Faits et procédure
Simon Bauer, industriel juif collectionneur d’art, est victime de spoliation en 1943 : 93 œuvres de sa collection d’art impressionniste sont confisquées dont des œuvres de Boudin, Degas ou encore Sisley. Parmi ces œuvres se trouvaient une gouache sur papier de Camille Pissarro, La Cueillette des pois, acquise auprès du célèbre marchand d’art parisien de la rue La Boétie, Paul Rosenberg, frère de Léonce et grand-père d’Anne Sinclair, défenseur des impressionnistes puis découvreur des cubistes. Le Commissariat aux questions juives de Vichy confie la vente des tableaux de la collection Bauer au marchand de tableaux Jean-François Lefranc, La Cueillette des pois. Quant à Simon Bauer, il est interné à Drancy et évitera la déportation à la suite d’une grève de cheminots. Après la guerre, il tentera de récupérer sans succès ses tableaux, dont le Pissarro, et ses héritiers reprendront son combat après son décès en 1947.
Au sortir de la guerre et à la faveur de l’ordonnance du 21 avril 1945[1], le président du Tribunal civil de la Seine constate la nullité de la vente des biens de Simon Bauer et ordonne la restitution des tableaux spoliés. Cette ordonnance sera confirmée par un arrêt du 4 mai 1951 de la Cour d’appel de Paris. Malgré le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, le tableau ne sera jamais restitué aux ayants droit.
Le tableau resurgit en 2017 à l’occasion d’une exposition consacrée à Pissarro au musée Marmottan-Monet, « Pissarro, le premier des impressionnistes ». L’œuvre est alors saisie par les ayants droit de Simon Bauer et la justice française ordonne aux propriétaires de restituer le tableau. Ces derniers, les Toll, se trouvent être un couple de collectionneurs américains affirmant ignorer le passé du tableau au moment de son acquisition lors d’une vente aux enchères organisée par Christie’s en 1995 pour 800.000 dollars.
Une bataille juridique de trois ans s’engage alors durant laquelle l’œuvre est conservée sous séquestre dans un coffre-fort du musée d’Orsay. Aux termes de celle-ci, le 1er juillet 2020[2], la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 octobre 2018 : la restitution du tableau est ordonnée et les Toll ne sont pas indemnisés à hauteur des 800.000 dollars déboursés en 1995. En effet, pour la Haute Cour, en cas de spoliation et de nullité de la confiscation irrévocablement constatée, « les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires ».
Les ayants droit se voient donc restituer la gouache qui sera une nouvelle fois vendue en 2021, cette fois-ci pour une somme de 3.382.200 euros. Le couple d’américains décide alors de saisir le juge administratif de Paris afin de condamner l’Etat à leur verser la somme correspondant à la vente du tableau en 2021 en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de la restitution de La Cueillette des pois. Le 16 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris rejette leur demande et les Toll font appel de la décision.
Par un arrêt du 14 février 2025, la Cour administrative d’appel rejette à nouveau leur requête.
II – Pas de lien de causalité direct entre le préjudice et l’application de la loi
Les Toll, qui recherchaient la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques du fait des lois en raison de l’application par les juridictions judiciaires de l’ordonnance du 21 avril 1945 précitée, « ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice dont ils se prévalent et l’application de la loi, les juridictions judiciaires leur ayant opposé, en dernier lieu, la nullité de la vente du tableau en cause ».
Dès lors, leur bonne foi n’a aucune incidence sur l’établissement de ce lien de causalité tout comme n’a pas d’incidence le fait qu’ils seraient privés d’un droit au recours effectif contre le vendeur en raison de la prescription.
Pour le couple américain, ce lien de causalité direct existait bel et bien entre l’application de l’ordonnance et son interprétation par les tribunaux et le préjudice subi.
Les circonstances postérieures à la décision du Tribunal civil de la Seine du 8 novembre 1945, confirmée en 1951 par la Cour d’appel de Paris, qui ordonnait la restitution de l’œuvre, seraient sans lien avec l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945. Il est quand même intéressant de préciser ici ces circonstances :
- La gouache n’a jamais été restituée malgré la plainte déposée par les ayants droit de Simon Bauer le 1er juin 1965 ;
- La gouache a fait l’objet d’une saisine entre les mains du nouvel acquéreur, le juge d’instruction ordonnant par la suite sa restitution entre les mains de celui-ci ;
- Une licence d’exportation a été délivrée le 16 février 1966 à la suite de l’avis favorable de la Direction des musées de France.
En d’autres termes, ces éléments, qui ont nécessairement conforté la croyance des Toll en une possession légitime de l’œuvre, sont intervenus après la décision d’annulation de la vente prononcée par le Tribunal civil de la Seine en 1945 et ne résultent pas de l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945, ils ne peuvent donc fonder la demande d’indemnisation par l’Etat de leur préjudice puisqu’il n’y pas de lien entre l’ordonnance précitée et ledit préjudice.
La solution paraît quelque peu sévère pour le couple d’américains, de bonne foi et qui ne peut se retourner contre le vendeur et les intermédiaires éventuels, d’autant plus que des professionnels établis et reconnus du marché de l’Art (Christie’s et Sotheby’s pour ne pas les citer) sont intervenus dans la chaîne d’acquisitions successives. D’autre part, l’Etat français lui-même a contribué à la restitution de l’œuvre dans les mains de l’acquéreur après sa saisine en 1965 avant de délivrer une licence d’exportation.
Il n’en reste pas moins que l’arrêt incitera les collectionneurs privés à vérifier la provenance des œuvres qu’ils acquièrent. Quant aux collectionneurs étrangers plus spécifiquement, ils pourraient être découragés par un prêt en France d’une œuvre de leur collection qui risquerait d’être saisie à cette occasion.
III – Pour aller plus loin
Dès 1943 et l’ordonnance du 12 novembre[3] relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, la France libre manifestait sa volonté de combattre également les tentatives d’expropriation des œuvres présentes sur le territoire français. A la libération, cette ordonnance sera déclarée valide par une autre ordonnance du 9 août 1944[4] relative au rétablissement de la légalité républicaine.
L’ordonnance du 21 avril 1945, fondamentale pour la revendication des biens spoliés, permet, aux personnes physiques et morales ainsi qu’à leurs ayants droit, de faire constater la nullité de tous les actes de disposition accomplis par suite des spoliations intervenues en vertu des textes législatifs et réglementaires établis par le gouvernement de Vichy, et ainsi en revendiquer la propriété, cette revendication pouvant s’appuyer indifféremment sur l’une des deux ordonnances de 1943 ou 1944 précitées. Cette ordonnance créait ainsi une nullité spéciale pour les personnes spoliées et leurs ayants droits qui pouvaient agir en nullité jusqu’au 31 décembre 1951, le juge ayant la possibilité de relever la forclusion dans l’hypothèse où le propriétaire dépossédé démontrait son impossibilité matérielle d’agir. D’autre part, l’ordonnance instaurait une présomption de mauvaise foi à l’égard de l’acquéreur final et des acquéreurs successifs permettant d’écarter l’application de la règle de l’article 2276 du Code civil actuel.
Après une intense utilisation dans les années suivant la Libération, l’ordonnance de 1945 sombra peu à peu dans l’oubli jusqu’à la commission Mattéoli en 1997, mission d’étude sur la spoliation des Juifs en France, qui engendra une nouvelle vague d’indemnisations et de restitutions. Cette régénération de l’ordonnance se matérialisa juridiquement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 1999[5] qui constata la nullité d’une vente aux enchères faite en 1941, par le célèbre commissaire-priseur Maurice Rheims, en faisant application de l’ordonnance de 1945 et de ses dispositions relatives au relevé de forclusion. Cependant, à la suite de cette décision, aucune autre application de l’ordonnance du 21 avril 1945 n’avait eu lieu jusqu’au litige relatif à la gouache de Pissarro.
[1] Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application du l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi
[2] Cass. Civ., 1ère chambre, 1 juillet 2020, 18-25.695, Inédit
[3] Ordonnance du 12 novembre 1943 solennelle signée à Londres le 5 janvier 1943 par le Comité National de la Libération Nationale et 17 gouvernements alliés : nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle
[4] Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continentale
[5] CA Paris, 1ère chambre, 2 juin 1999, 1998/19209