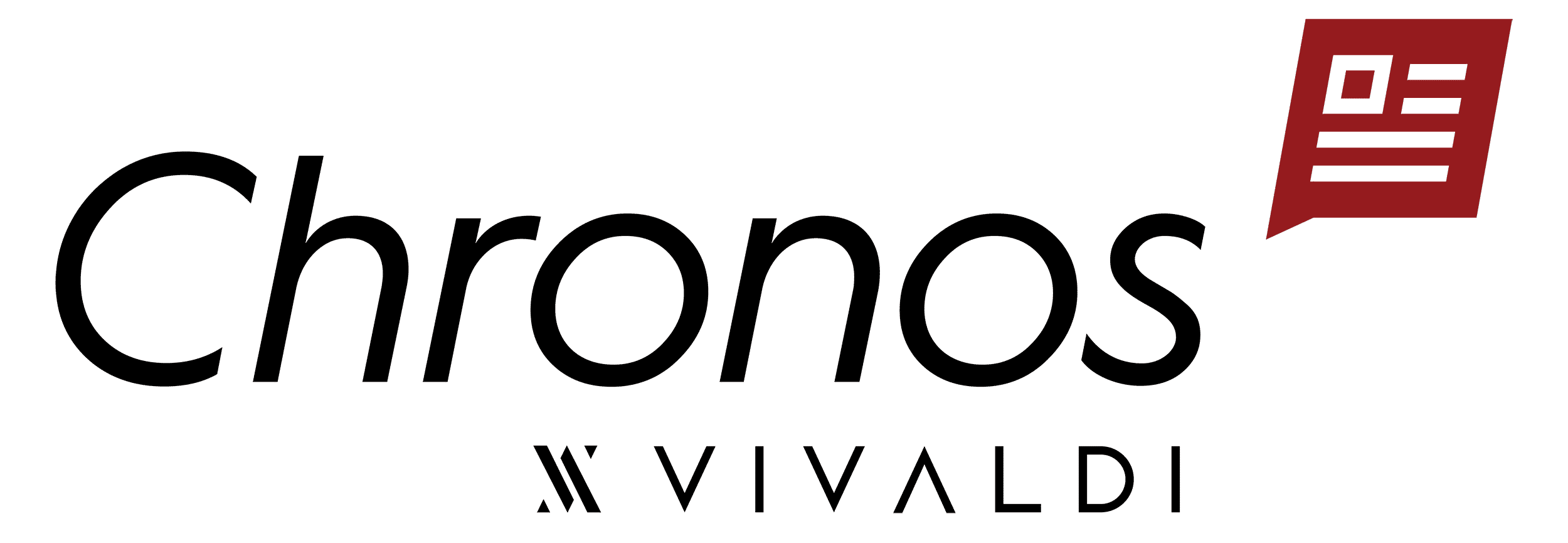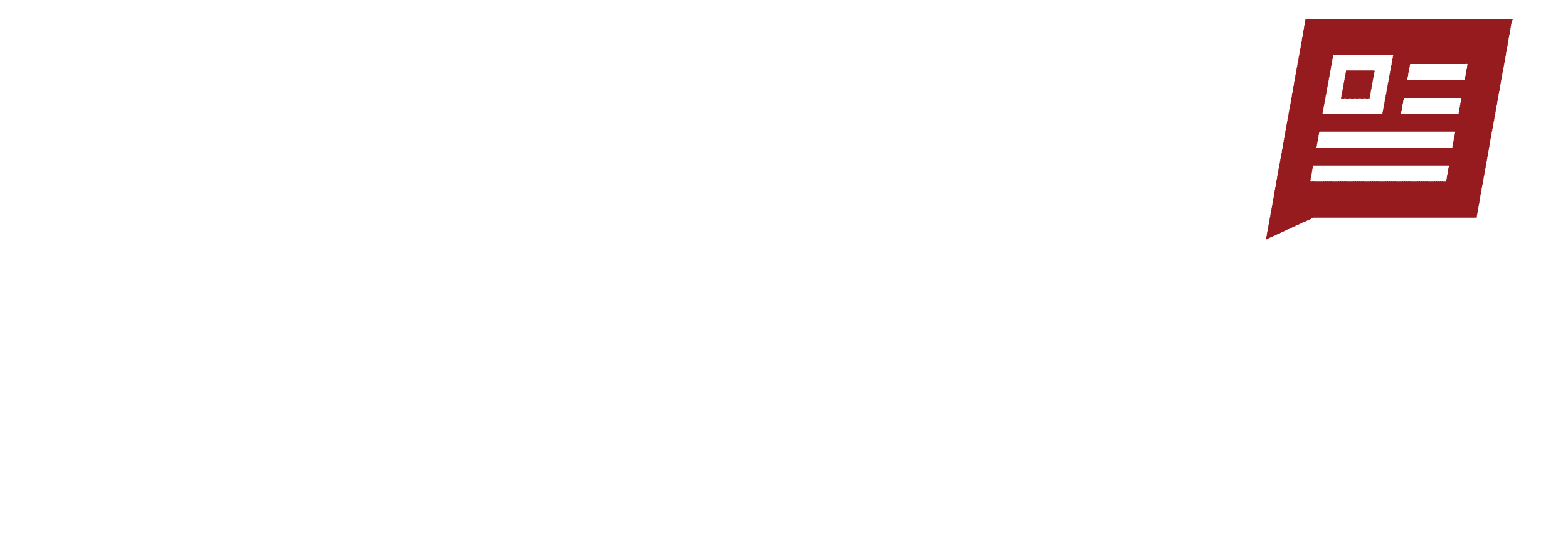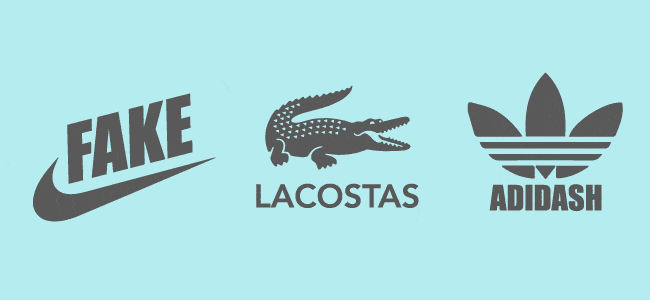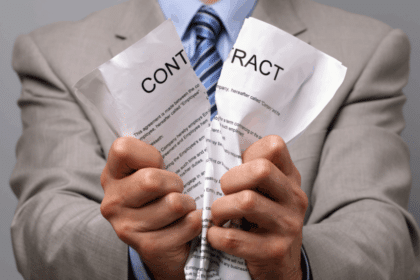Quand la pluralité d’acteurs met à l’épreuve l’obligation de résultat
La Cour de cassation affirme que l’entrepreneur chargé de l’entretien ou de la réparation d’une installation de chauffage est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité, dont il ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère. En écartant une lecture trop étroite de la mission contractuelle retenue par la cour d’appel, elle consacre une conception objective et renforcée de la responsabilité contractuelle, y compris en présence d’interventions successives de plusieurs intervenants. Civ. 1ère, 28 janv. 2026, FS-B, n° 24-15.298 I - Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation réaffirme avec vigueur les principes gouvernant la responsabilité contractuelle des professionnels appelés à intervenir sur des installations présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens. À la suite d’un incendie d’habitation dont l’origine se situait au niveau du tableau de commande d’une chaudière, la Haute juridiction était amenée à préciser la portée de l’obligation de sécurité pesant, d’une part, sur l’entreprise chargée de l’entretien annuel de l’installation et, d’autre part, sur celle intervenue ponctuellement pour remédier à un dysfonctionnement identifié. Par un…
Pressions tarifaires et déséquilibre significatif : la grande distribution dans le viseur de l’administration
Le déséquilibre significatif n’est pas exclu par principe lorsque les parties disposent d’une puissance économique comparable. Il peut résulter de l’écart entre l’ampleur de la réduction de prix consentie et la faiblesse, voire l’absence, de contrepartie. Dans le cadre des enquêtes, l’administration est en droit de poser des questions orientées susceptibles d’amener l’opérateur à se compromettre, le procès-verbal demeurant recevable dès lors que les réponses recueillies ne constituent pas une auto-incrimination caractérisée. Com. 7 janv. 2026, FS-B, n° 23-20.219 I - L’arrêt ITM présente un intérêt particulier en droit des pratiques restrictives de concurrence. Il s’inscrit dans le contexte spécifique de la « guerre des prix » menée en 2013 et 2014, au cours de laquelle les distributeurs français, invoquant la volonté de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs, ont recherché des baisses de prix substantielles auprès de leurs fournisseurs. En dehors de ce contexte conjoncturel, l’affaire revêt un caractère relativement classique. À l’issue d’une enquête administrative, la société ITM, exploitant notamment les enseignes Intermarché et Netto, s’est vu reprocher d’avoir mis en œuvre, dans le cadre d’un plan d’action…
Vente des murs et droit de préférence du locataire : l’action en nullité enfermée dans le délai biennal
La cession à un tiers de locaux à usage commercial ou artisanal consentie par le propriétaire en violation du droit de préférence du locataire commerçant est frappée de nullité, l’action en nullité ouverte au profit du locataire étant soumise au délai de prescription biennal. Civ. 3ème, 18 déc. 2025, FS-B, n° 24-10.767 I - Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, le locataire commerçant bénéficie d’un droit de préférence en cas de cession des locaux qu’il occupe. Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation précise que la méconnaissance de ce droit par le bailleur est sanctionnée par la nullité de la vente, à condition toutefois que le locataire exerce son action dans le délai de prescription biennale. En l’espèce, un immeuble donné à bail à un EHPAD depuis 2010 avait été vendu en 2017 sans que le droit de préférence du preneur soit respecté. En 2020, le nouvel acquéreur notifia à la locataire son intention de revendre l’immeuble, cette fois dans le respect des exigences de l’article L. 145-46-1 du code de commerce.…
Résiliation anticipée du contrat : l’indemnisation du créancier limitée à l’exécution effective
En cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le préjudice subi par le créancier à l’initiative de la résiliation ne peut être qualifié de perte de chance d’obtenir le paiement de l’intégralité du solde contractuel. Lorsqu’un contrat à durée déterminée est résilié de manière anticipée à l’initiative du créancier, le préjudice invoqué ne saurait s’analyser en une perte de chance de percevoir le solde intégral du marché. Com. 3 déc. 2025, F-B, n°24-17.537 I - Résilier un contrat cinq mois avant son terme peut-il s’avérer plus avantageux que de l’exécuter jusqu’à son échéance ? C’est à ce paradoxe que conduisait la solution retenue par les juges du fond dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 2025. Deux sociétés étaient liées par un contrat d’entreprise à durée déterminée. Se prévalant d’un manquement grave de son cocontractant, le créancier a procédé à la résiliation unilatérale du contrat cinq mois avant la date de livraison prévue, avant d’assigner le débiteur en paiement du solde du prix afférent à la partie non exécutée,…
Saisie contrefaçon : du statut de victime à celui de dénigreur
La chambre commerciale de la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que l’existence d’une saisie-contrefaçon réalisée dans le cadre d’une action en contrefaçon de droit d’auteur ne légitime pas le fait d’alerter des tiers sur une prétendue contrefaçon. Une telle communication constitue un dénigrement dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a encore établi l’atteinte alléguée. Si l’arrêt ne fait que réaffirmer une jurisprudence bien établie, il rappelle fermement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la prudence qui s’impose dans leurs prises de parole avant tout jugement. Com. 15 oct. 2025, F-B, n° 24-11.150 I - L’arrêt commenté concerne une société commercialisant un carillon à vent en bois fabriqué de manière artisanale. Estimant qu’une société concurrente commercialisait un modèle contrefaisant, elle a obtenu, par ordonnance du 22 septembre 2022, une saisie-contrefaçon exécutée le 9 novembre suivant. Parallèlement, elle a adressé des mises en demeure aux distributeurs de la société concurrente et de son prestataire, leur demandant de cesser toute distribution des produits litigieux. Ces derniers ont alors engagé, en référé, une action en dénigrement, estimant que…
La garantie du locataire cédant éteinte par la transaction conclue avec le cessionnaire
Bien que la transaction ne produise d’effets qu’entre les seules parties qui l’ont conclue, elle constitue, pour un tiers, un fait juridique. Dès lors, un codébiteur solidaire, même non-signataire, peut se prévaloir des engagements pris dans la transaction entre le créancier commun et un autre coobligé, dès lors que celle-ci confère à ce dernier un avantage dont il peut également profiter. Civ. 3ème, 6 nov. 2025, FS-B, n° 24-10.745 I - Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation juge que, malgré le principe de l’effet relatif des contrats, une transaction conclue entre le bailleur et le locataire cessionnaire — par laquelle le bailleur renonce à une partie des arriérés de loyers — profite également à l’ancien locataire cédant, garant des loyers, bien qu’il n’ait pas été partie à cette transaction. En l’espèce, un locataire avait cédé son fonds de commerce à une société cessionnaire, l’acte de cession prévoyant une garantie solidaire du cédant pour le paiement des loyers. Comme le rappellent les articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce, la garantie du cédant est strictement encadrée :…
Clause résolutoire à quinze jours : réputée non écrite et impact de la loi Pinel sur les baux en cours
La clause résolutoire d’un bail commercial prévoyant un délai de mise en demeure inférieur à un mois doit être entièrement réputée non écrite, en application de l’article L. 145-15 du code de commerce tel que modifié par la loi du 18 juin 2014. Cette loi s’applique aux baux en cours lors de son entrée en vigueur, dès lors que l’action visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire a été engagée après cette date et que les effets du commandement ne sont pas définitivement consommés (2 espèces). Civ. 3e, 6 nov. 2025, FS-B, n° 23-21.334 I - Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, une clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant impérativement mentionner ce délai sous peine de nullité. Depuis longtemps, la jurisprudence considère que cette exigence d’ordre public concerne non seulement la rédaction du commandement mais également celle de la clause résolutoire elle-même. Ainsi, une clause fixant un délai de quinze jours est dépourvue d’effet, de même qu’une clause prévoyant « trente jours », ce délai n’équivalant pas toujours…
Baux 9 ans : le déplafonnement sans amortisseur
L’étalement des hausses de loyer n’est permis qu’en cas de déplafonnement fondé sur une modification notable de l’un des quatre premiers critères de la valeur locative, ou lorsque le bail a une durée contractuelle excédant neuf ans. En revanche, il ne s’applique pas aux baux initialement conclus pour neuf ans qui ont simplement été prolongés tacitement au-delà de douze ans. Civ. 3ème, 16 oct. 2025, FS-B, n° 23-23.834 I - La loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, a introduit à l’article L. 145-34 du code de commerce un dernier alinéa limitant à 10 % par an l’augmentation du loyer déplafonné. Cette limitation vise les hypothèses où le déplafonnement résulte d’une modification notable de l’un des quatre premiers éléments de la valeur locative, ou lorsque le bail déroge au plafonnement en raison d’une durée contractuelle excédant neuf ans. La Cour de cassation a déjà précisé que l’étalement prévu par ce texte consiste en une majoration annuelle fixe et non modulable de 10 % du loyer de l’année…
Relevé d’office et respect du contradictoire : la vigilance s’impose au juge d’appel
L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en appel par une décision passée en force de chose jugée ne peut, en principe, déposer de nouvelles conclusions devant la cour de renvoi. Toutefois, la procédure de renvoi après cassation ne constituant pas une instance nouvelle — l’instruction reprenant dans l’état où elle se trouvait avant la cassation —, cet intimé doit être autorisé à conclure sur le moyen relevé d’office, mais uniquement dans les limites de ce moyen. Civ. 2ème, 11 sept. 2025, FS-B, n° 22-22.155 I - La règle est ferme : irrecevable un jour, irrecevable toujours. Dans cette affaire, un intimé, dont les conclusions avaient été jugées tardives en appel, tentait de plaider à nouveau devant la cour de renvoi après cassation. Mais la Cour de cassation confirme qu’une ordonnance d’irrecevabilité devenue définitive, faute de déféré, s’impose à la juridiction de renvoi. L’intéressé ne peut donc plus conclure dans la nouvelle instance, car le renvoi ne constitue pas une procédure autonome : il ne fait que reprendre l’instruction dans l’état où elle se trouvait avant la cassation. Deux…
Le contentieux privé de la concurrence à l’épreuve du temps : nouvelles précisions sur la prescription
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle sur le régime de prescription applicable en droit espagnol, a précisé le point de départ du délai pour agir en réparation d’une infraction au droit de la concurrence. Au nom du principe d’effectivité, elle a jugé que ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision de sanction de l’autorité nationale de concurrence ne soit devenue définitive. Autrement dit, la prescription débute, en pratique, à la date de publication de l’arrêt confirmant cette décision. CJUE. 4 septembre 2025, aff. C-21/24 I - Depuis le début des années 2000, le contentieux privé de la concurrence connaît un essor considérable. Des grands arrêts fondateurs à la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, les institutions européennes ont multiplié les initiatives pour faciliter les actions en réparation introduites par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Pour autant, certaines questions demeuraient en suspens. Par son arrêt récent, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une clarification importante concernant le régime de prescription applicable dans ce domaine. En l’espèce, la Commission nationale des…
Déloyauté professionnelle et confidentialité : enseignements récents de la Cour
Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît explicitement comme acte de déloyauté le détournement d’informations confidentielles, précédemment sanctionné contre d’anciens salariés, cette fois à l’encontre d’un ancien dirigeant. Plus encore, il apparaît que la Cour attache peu d’importance au caractère stratégique de ces informations pour caractériser la déloyauté, dès lors qu’elles restent confidentielles. Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.078 I - L’arrêt du 24 septembre 2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie la qualification de la déloyauté lorsqu’il s’agit du détournement d’informations confidentielles. L’affaire concerne un ancien mandataire social d’une association de passionnés de véhicules Volkswagen qui, avec un associé, avait créé une société concurrente organisant des événements automobiles sur le même site qu’un festival précédemment organisé par l’association. L’association avait assigné la société et ses dirigeants pour concurrence déloyale et parasitisme, estimant que la transmission par l’ancien vice-président de sa balance comptable, document confidentiel, à la nouvelle société constituait un acte de déloyauté. La Cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande, considérant que le…
Traitement des micro-pratiques anti-concurrentielles, l’arrangement à la place d’un procès
La Cour de cassation précise que, dans le cadre d’une micro-pratique anticoncurrentielle, la saisine de l’Autorité de la concurrence par la DGCCRF intervient in rem, de sorte que l’Autorité n’est pas liée par l’analyse préalable de la DGCCRF. Elle admet également que cette dernière peut proposer une transaction à une personne morale isolée au sein d’un groupe, afin de respecter sa compétence en matière de micro-PAC. Cette décision renforce la coordination entre les deux institutions et incite les entreprises à privilégier la transaction devant la DGCCRF pour éviter des sanctions plus lourdes. Com. 24 sept. 2025, FS-B, n° 23-13.733 I - L’arrêt du 24 septembre rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des enseignements importants sur la procédure applicable aux micro-pratiques anticoncurrentielles (micro-PAC) et sur l’articulation entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence. En l’espèce, une société avait participé à un appel d’offres public en coordonnant certaines informations avec un concurrent, ce que la DGCCRF a analysé comme une entente. Après que la société a refusé la transaction proposée, la DGCCRF a saisi l’Autorité de…