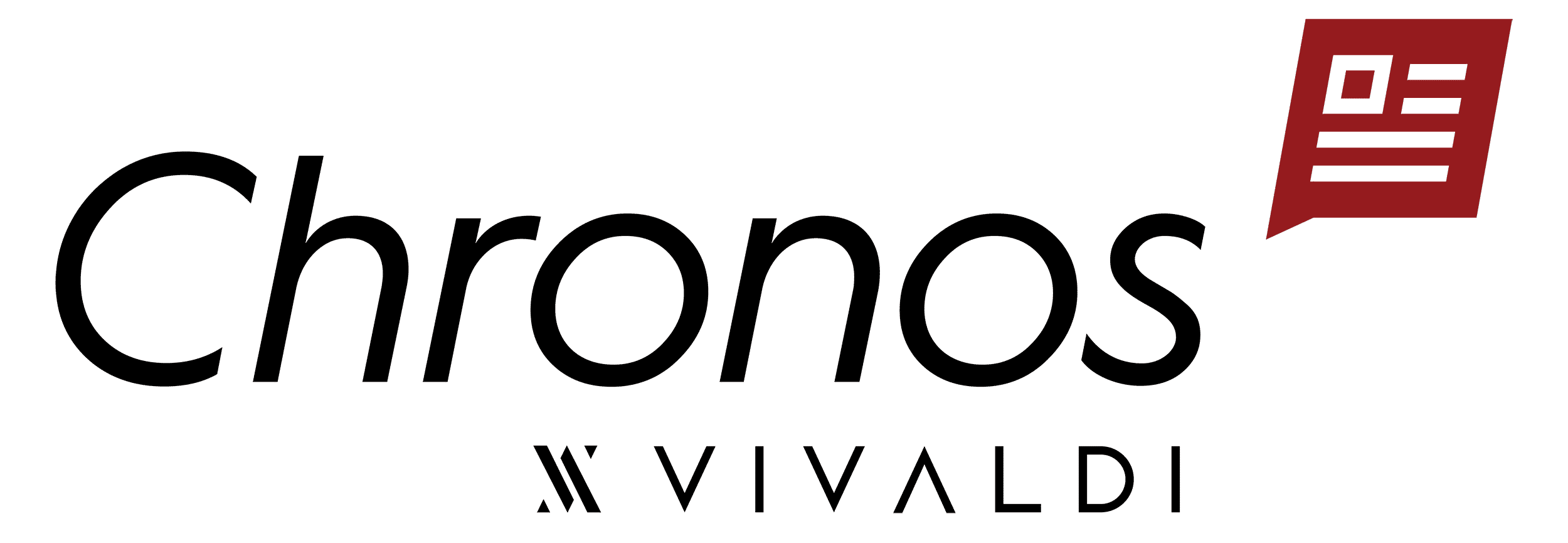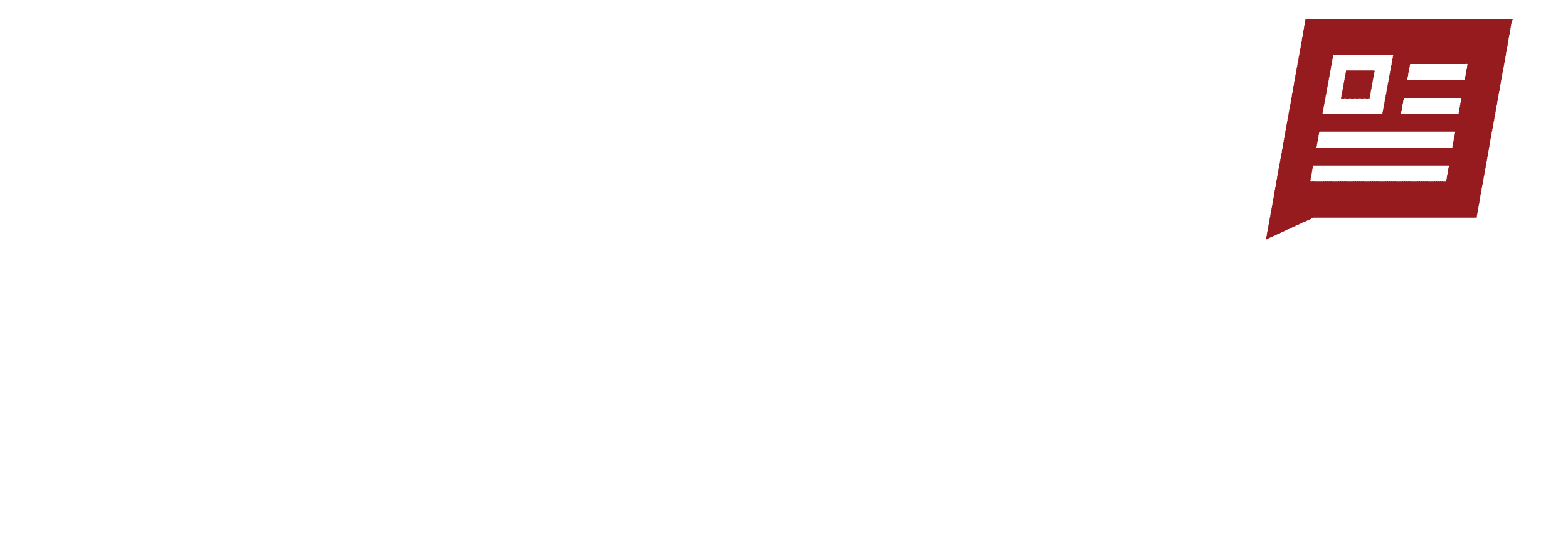Annulation de la vente pour dol résultant de la dissimulation de troubles anormaux de voisinage : étendue des restitutions et limites de l’indemnisation
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861, n° 14 D https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053384200?init=true&page=1&query=23-23.861&searchField=ALL&tab_selection=all La vente d’un immeuble d’habitation peut être annulée lorsque le vendeur a volontairement dissimulé à l’acquéreur l’existence de troubles anormaux de voisinage affectant le bien vendu, notamment des nuisances sonores provenant d’une activité commerciale voisine. Une telle dissimulation constitue un dol, au sens de l’article 1110 ancien du code civil (devenu art. 1137 depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), dès lors qu’elle a déterminé le consentement de l’acquéreur. En l’espèce, une maison d’habitation mitoyenne d’un commerce est vendue à des époux. Se plaignant de nuisances sonores excessives liées à l’exploitation de ce commerce, les acquéreurs assignent le vendeur ainsi que la société exploitante en nullité de la vente et en réparation de leurs préjudices. 1. Annulation de la vente et intérêts d’emprunt : l’omission de statuer La cour d’appel fait droit à la demande d’annulation de la vente pour dol, mais rejette la demande des acquéreurs tendant au remboursement des intérêts d’emprunt versés pour financer l’acquisition, au motif que les prêts étaient eux-mêmes appelés à être…
Vice caché : transparence du vendeur et contrôle par l’agent immobilier
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 novembre 2025, 23-18.899, Inédit La clause d’exonération de garantie des vices cachés ne protège pas un vendeur qui avait connaissance des défauts du bien vendu. Par ailleurs, l’agent immobilier chargé de la transaction doit vérifier la véracité des déclarations du vendeur, notamment lorsqu’elles portent sur l’entretien d’éléments essentiels tels que la toiture. 1. Exclusion de la clause d’exonération pour le vendeur connaissant le vice Dans cette affaire, une propriétaire a vendu une maison à un couple par l’intermédiaire d’un agent immobilier. Les acquéreurs ont découvert plusieurs désordres significatifs, principalement au niveau de la toiture, et ont assigné la venderesse et le mandataire pour obtenir réparation. La cour d’appel avait rejeté les demandes en considérant que la venderesse n’avait pu connaître le défaut de pente de la toiture, que ce défaut n’était perceptible qu’à un professionnel, et que l’état général de vétusté ne constituait pas un vice caché. La clause d’exonération de garantie stipulant que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans…
Vente entre professionnels de même spécialité : portée de la clause de non-garantie des vices cachés
La validité d’une clause exonératoire de garantie des vices cachés dépend de l’analyse concrète de la qualité des parties et de leur spécialité professionnelle. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 23-18.469 23-18.508 23-18.560, Inédit Dans cette affaire, l’acte de vente d’un immeuble à usage de bureaux était accompagné de trois rapports de diagnostic réalisés par deux professionnels différents, indiquant l’absence d’amiante. Trois ans après l’acquisition, le nouveau propriétaire découvre la présence d’amiante et assigne le vendeur, les diagnostiqueurs et leurs assureurs en réparation de ses préjudices. Au fond, les juges avaient reconnu la responsabilité du vendeur malgré l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, en considérant que l’acquéreur et le vendeur appartenaient à la même spécialité professionnelle. Ils avaient également limité les demandes envers les diagnostiqueurs à une simple perte d’information, estimant que la non-détection d’amiante ne privait l’acquéreur que d’une chance de négocier différemment. La Cour de cassation casse cette décision aux motifs suivants : Observations jurisprudentielles En synthèse, cette décision illustre deux points clés :
Servitude de passage : priorité sur les terrains issus d’une division foncière
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 novembre 2025, 24-17.240, Publié au bulletin Le droit de passage pour cause d’enclave permet au propriétaire d’un immeuble dépourvu d’accès à la voie publique de réclamer l’institution d’une servitude sur les terrains voisins (C. civ., art. 682). En principe, ce droit peut s’exercer sur n’importe quel terrain avoisinant, en choisissant le trajet le plus court et le moins dommageable pour les propriétaires grevés (C. civ., art. 683). Cependant, lorsque l’enclavement résulte directement de la division d’un fonds unique, le passage doit être institué prioritairement sur les parcelles issues de cette division (C. civ., art. 684). Faits et procédure En 2017, un propriétaire vend une partie de ses parcelles à une société. Une autre portion des terrains, constituant l’accès à la voie publique, avait été vendue dès 2013 à d’autres acquéreurs. La société se retrouve avec des parcelles enclavées et assigne les propriétaires voisins pour faire fixer l’assiette d’une servitude de passage. Les propriétaires s’opposent, arguant que l’enclavement résulte de la division du fonds unique en 2013 et que, conformément à l’article 684…
Responsabilité professionnelle de l’architecte et assurance : l’exemple d’une erreur de calcul de surface
L’assureur professionnel d’un maître d’œuvre ou d’un architecte est tenu d’indemniser le maître d’ouvrage pour les dommages financiers causés par une faute ou une erreur dans l’exécution de la mission confiée. Trib. jud. Rouen, 25 sept. 2025, n° 25/01609 Un maître d’ouvrage confie à un architecte la conception et la réalisation d’un immeuble destiné à la vente. Le permis de construire, déposé par l’architecte, indique une surface de plancher de 290 m², conforme à la demande initiale du maître de l’ouvrage. Sur cette base, une vente est conclue pour un montant total de 1 044 000 € TTC. À l’issue des travaux, il apparaît que la surface réelle de l’immeuble est inférieure à celle mentionnée dans les plans initiaux. Plusieurs plans topographiques révèlent des divergences, confirmant que l’architecte a commis une erreur dans l’estimation de la surface. Cette erreur entraîne une réduction du prix de vente à 938 416 € TTC, générant un préjudice financier de 105 584 € pour le maître de l’ouvrage. Le tribunal judiciaire constate que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles en établissant…
Prescription biennale en assurance : inopposabilité en cas d’information insuffisante
Lorsqu’un contrat d’assurance se limite à mentionner de manière partielle les dispositions légales relatives à la prescription, le délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances peut être écarté à l’égard de l’assureur. CA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 23/03649 Dans cette affaire, des époux constatent des fissures sur l’enduit de la façade de leur immeuble. Ils assignent en référé expertise le 23 décembre 2016 un constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale. Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 16 février 2018, ils assignent les parties au fond le 6 août 2021. Le constructeur appelle ensuite en garantie son assureur responsabilité civile décennale le 20 novembre 2022. Le juge de la mise en état déclare l’action prescrite, en application du 3ᵉ alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, considérant que l’action en référé constitue une action en justice déclenchant le délai de prescription biennale. La cour d’appel confirme que l’action en référé constitue bien un acte interruptif de prescription au sens de L. 114-1, alinéa 3, mais constate que l’information contractuelle sur la prescription…
Réception impossible : responsabilité contractuelle des constructeurs engagée.
Lorsque des désordres majeurs affectent un ouvrage, qu’un solde reste impayé et qu’une partie de l’ouvrage doit être détruite pour être reconstruite, aucune réception, tacite ou judiciaire, ne peut être considérée comme intervenue. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle des constructeurs est pleinement engagée. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 22-20.146, Inédit Dans cette affaire, un maître d’ouvrage confie à un architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à une entreprise la réalisation des lots gros œuvre, maçonnerie, abords, toiture et piscine. Constatant des désordres importants, il obtient en référé la désignation d’un expert et assigne ensuite les constructeurs en réparation des dommages et indemnisation de son préjudice de jouissance. Les juges du fond constatent : En conséquence, ils écartent l’existence d’une réception tacite ou judiciaire et condamnent les constructeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. La Cour de cassation approuve cette décision. Elle souligne que : En synthèse, cet arrêt illustre que :
Prescription de l’action de l’entreprise principale contre l’assureur du sous-traitant
Le point de départ de la prescription quinquennale est subordonné à l’acquisition d’une connaissance complète et chiffrée du dommage par l’entreprise générale. Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-22.017, n° 565 D Une entreprise générale, intervenant à la fois comme constructeur et comme vendeur, avait confié à un sous-traitant, dans le cadre d’un contrat-cadre, la réalisation de travaux de pose de poêles et d’inserts au domicile de ses clients. Dès 2012, des dysfonctionnements affectant certaines installations ont conduit l’entreprise principale à alerter sa clientèle sur les risques encourus et à procéder à plusieurs déclarations de sinistre auprès de son assureur. Estimant que la sécurité des utilisateurs était compromise, l’entreprise générale a pris l’initiative de faire exécuter l’ensemble des travaux de reprise nécessaires, qu’elle a intégralement financés par avance. Elle a parallèlement indemnisé certains clients à titre transactionnel. Afin d’identifier l’origine des désordres et d’en apprécier la gravité, plusieurs expertises amiables ont été diligentées au cours des années 2013 et 2014. Ce n’est qu’à l’issue de ces investigations techniques que l’entreprise générale a estimé être en mesure de rattacher les…
Les limites de l’efficacité de la clause exonératoire de garantie des vices cachés
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 novembre 2025, 24-11.221, Inédit La clause de non-garantie des vices cachés insérée dans un acte de vente ne produit pas d’effet lorsque les désordres affectant l’immeuble trouvent leur origine dans des travaux réalisés personnellement par le vendeur. En l’espèce, les acquéreurs d’une maison d’habitation, se plaignant de multiples désordres révélés après la vente, ont assigné leurs vendeurs à l’issue d’une expertise judiciaire. Ils ont agi sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicitant à la fois la résolution de la vente et l’allocation de dommages-intérêts. Bien que l’acte de vente contienne une clause exonératoire de garantie, les juges du fond ont fait droit à leurs demandes. Ils ont relevé, d’une part, la gravité des désordres, lesquels portaient atteinte à la structure même de l’immeuble, et, d’autre part, le fait déterminant que les travaux à l’origine des vices avaient été exécutés par les vendeurs eux-mêmes. Il ressortait du dossier que ces travaux, réalisés sur une période de plus de dix ans, incluaient des interventions substantielles sur des éléments porteurs de la…
Légitimité du droit d’agir en justice et caractérisation de l’abus de droit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 novembre 2025, 23-23.791, Inédit L’exercice d’une action ou d’une défense en justice constitue un droit fondamental qui ne saurait, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par une juridiction. La seule persistance dans le contentieux ou le refus de transiger ne suffit pas, en soi, à caractériser une faute engageant la responsabilité civile de son auteur. En l’espèce, les acquéreurs d’un immeuble d’habitation, se plaignant de divers désordres affectant le bien, ont assigné leur vendeur à l’issue d’une expertise judiciaire, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le litige suivait ainsi un schéma classique en droit immobilier. Déboutés de l’ensemble de leurs demandes en première instance, les acquéreurs ont toutefois obtenu gain de cause devant la cour d’appel. Celle-ci a retenu la qualité de professionnel du bâtiment du vendeur ainsi que sa connaissance des vices affectant l’immeuble, ce qui justifiait que soit mis à l’écart la clause contractuelle d’exonération de garantie. Sur ce point, la solution s’inscrivait dans une jurisprudence…
La VEFA requalifiée en marché public de travaux lorsque l’acheteur public exerce une influence déterminante sur l’opération
CAA Lyon, 18 sept. 2025, n° 23LY02923 Lorsqu’un acheteur public suit et encadre l’ensemble des phases d’une opération immobilière réalisée en vue de l’acquisition d’un immeuble en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), il exerce une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage. Dans une telle hypothèse, le contrat ne peut être regardé comme une simple opération de vente immobilière privée et doit être requalifié en marché public de travaux. 1. Les faits et la procédure : une VEFA fortement encadrée par l’acheteur public En l’espèce, un office public d’HLM a cédé des parcelles en vue de la réalisation d’une opération immobilière comprenant la construction de son futur siège social, destiné à lui être rétrocédé par le biais d’une VEFA. Un différend étant né à l’occasion de l’exécution du contrat, l’office public de l’habitat a assigné le vendeur-promoteur devant le tribunal administratif de Lyon. Celui-ci s’est toutefois déclaré incompétent, estimant le litige de nature privée. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a infirmé cette analyse. Elle a jugé que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat…
Inopposabilité de la prescription en cas d’information contractuelle insuffisante
Le délai de prescription d’une action en assurance ne peut être opposé à l’assuré si le contrat ne mentionne pas de manière exhaustive les causes ordinaires d’interruption de la prescription, telles que prévues par les articles 2240 à 2246 du code civil. Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-11.128, n° 1103 D En septembre 2019, le propriétaire d’un immeuble déclare un sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles incluse dans son contrat d’assurance multirisques. Sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi en août 2020, l’assureur notifie en septembre 2020 qu’il refuse de garantir les conséquences du sinistre. L’assuré assigne alors l’assureur en référé expertise en octobre 2022. Le juge des référés rejette la demande comme prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances. En appel, l’assuré soutient que le délai de prescription biennale ne peut lui être opposé, invoquant une information insuffisante dans le contrat sur les causes ordinaires d’interruption de la prescription, telles que prévues par le code civil et rappelées par l’article R. 112-1 du code des assurances. La cour d’appel écarte…